Synthèse
Longtemps reléguée à la périphérie du regard national, la ruralité a émergé ces dernières années comme un espace politique à part entière. Pourtant, lorsqu’on observe l’égalité femmes-hommes depuis ces territoires, une évidence s’impose : si la ruralité ne crée pas les inégalités de genre, elle les amplifie. Ce phénomène touche 11 millions de femmes, soit un tiers des Françaises, vivant sur 91,5 % du territoire et rarement considérées dans les politiques publiques, les données statistiques ou les récits contemporains.
Une pluralité de profils unifiée par la même contrainte : la distance
Loin de la figure monolithique de la « femme rurale », l’étude révèle une réalité composite : 32 % appartiennent aux catégories socioprofessionnelles inférieures, 23 % aux catégories socioprofessionnelles supérieures, et 45 % sont inactives. Non par choix, mais sous l’effet de carrières discontinues, de temps partiels subis et d’un marché du travail moins diversifié. En dépit de cette diversité, une même expérience structure leur quotidien : l’éloignement. Écoles, médecins, formations, services administratifs…, en ruralité, chaque démarche requiert temps, carburant et organisation. L’immense majorité de ces coûts logistiques retombe sur les femmes.
Des mécanismes de domination identiques partout, mais renforcés hors des villes
Le travail domestique, matrice de toutes les inégalités
Comme en ville, les femmes font la majeure partie des tâches domestiques. Mais à la campagne, ce travail s’adosse à des distances plus longues et à moins d’alternatives. C’est ainsi que 86,5 % des femmes rurales gèrent les démarches administratives du foyer, 70 % les trajets scolaires, 74 % les activités extrascolaires. Ce qui, en ville, peut se mutualiser, se délègue rarement en ruralité.
Une sécurité économique fragile et profondément genrée
Plus d’une femme rurale sur deux (53 %) déclare ne pas se sentir en sécurité économique, un niveau proche des femmes urbaines (50 %) mais nettement supérieur à celui des hommes ruraux (38 %). Seules 40 % des femmes rurales parviennent à épargner régulièrement, contre 55 % des hommes ruraux. Et 27 % dépensent chaque mois plus qu’elles ne gagnent, soit 10 points de plus que leurs homologues masculins (17 %).
En ruralité, 69 % des femmes mariées, pacsées ou en concubinage déclarent que ce sont les revenus (salaire, retraite ou allocations chômage) de leur partenaire qui contribuent majoritairement aux revenus du couple. C’est 9 points de plus que leurs homologues urbaines (60 %).
Des trajectoires professionnelles balisées dès l’adolescence
Déjà, au lycée, l’effet territoire se conjugue au genre : les formations éloignées, les transports insuffisants et les coûts associés conduisent les jeunes filles à renoncer à certaines orientations. Près d’une femme sur deux déclare que leur trajectoire professionnelle a été limitée parce qu’elles étaient des femmes. Un pourcentage identique en ruralité et en ville, mais dont les conséquences sont plus lourdes lorsque les alternatives sont rares.
Le « malus rural du genre » : quand les distances démultiplient les écarts
Une charge mentale renchérie par la géographie
Si un tiers des urbaines (33 %) disent porter presque exclusivement la charge mentale du foyer, elles sont 40 % en ruralité. Les effets de ces tensions ne demeurent pas circonscrits à la sphère sociale et s’incarnent aussi dans la santé psychique.
Le temps personnel : la variable sacrifiée
Une femme rurale sur cinq (19 %) déclare avoir moins de deux heures par semaine pour elle-même, contre 7 % des hommes ruraux. Sous le seuil des cinq heures hebdomadaires, les écarts explosent : 47 % des femmes rurales ont moins de 5 heures pour elles, contre 25 % des hommes (22 points d’écart). C’est plus du double de l’écart observé chez les urbains.
Travail, responsabilités familiales et satisfaction : un différentiel qui se creuse
Les femmes rurales sont 38 % à estimer que leurs responsabilités familiales limitent leurs possibilités professionnelles, contre 17 % des hommes de leur territoire. Une nouvelle fois, l’écart est plus nettement supérieur (22 points) par rapport à celui observé en ville (16 points). La ruralité ne crée pas les écarts, elle les durcit.
Des trajectoires fémininesfaçonnées par l’espace
Partir ou rester : un choix géographique avant d’être scolaire
À 18 ans, l’exode étudiant réduit en un an la part des jeunes qui vivent dans les territoires ruraux. S’ils sont 33 % à 17 ans, à 18 ans ils ne sont plus que 24 % : une transformation brutale du paysage démographique, où les jeunes femmes partent davantage que les hommes. Celles qui restent sont majoritairement issues de milieux populaires, pour qui la mobilité représente des coûts impossibles à absorber.
Les normes locales : la respectabilité au féminin
Lorsqu’on demande aux femmes rurales ce que l’on attend d’elles :
- 57 % évoquent le fait de « bien s’occuper du foyer » ;
- 38 % « d’avoir des enfants » ;
- 36 % « d’être disponibles pour les autres ».
Se mettre en couple : un amortisseur économique à sens unique
La mise en couple améliore la situation matérielle des femmes rurales… tant qu’elle dure. Mais les patrimoines racontent une autre histoire : lorsque des enfants sont présents, 35 % des hommes sont propriétaires exclusifs du logement, contre 21 % des femmes (–14 points). Conséquence directe, plus d’un quart des femmes rurales (27 %) estiment qu’elles ne pourraient pas s’en sortir seules après une séparation (contre 9 % des hommes).
Accès aux droits : la promesse de l’égalité se heurte au réel
Santé et placement en crèche : un parcours d’obstacles continu
Dans les zones rurales, 63,6 % des femmes disent ne pas avoir accès rapidement à des soins adaptés. Les crèches accessibles en ruralité sont trois fois moins nombreuses qu’en zones urbaines (8 places pour 100 enfants contre 26).
Violences conjugales : un paradoxe rural
Les territoires ruraux concentrent 47 % des féminicides pour un tiers des femmes. Pourtant, seuls 26 % des appels au 3919 viennent des zones rurales. La proximité sociale, l’absence d’anonymat et l’éloignement des structures de protection rendent le recours à l’aide plus coûteux, plus risqué, plus rare.
Isolement, charge civique et ressentiment
Huit femmes rurales sur dix (79 %) se sentent isolées (85 % lorsqu’elles sont en couple sans enfant), contre 72 % de leurs homologues masculins.
Ce sentiment s’inscrit dans un contexte plus large ou le vote RN atteint des niveaux record dans les zones peu denses. Aux élections législatives de 2024, le parti obtient 42 % de voix en ruralité, contre environ 30 % en zones urbaines. Les femmes rurales sont le groupe qui a le plus voté pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2022, avec 31 %, soit un niveau supérieur à celui des hommes ruraux (24 %), des femmes urbaines (22 %) et des hommes urbains (20 %).
Pour une égalité réelle : l’accessibilité comme condition première
Le coeur de l’enjeu est simple : avoir un droit ne garantit pas qu’on puisse y recourir.
La ruralité transforme l’accès en coût de temps, d’argent, de mobilité, de confidentialité.
Des réponses émergent dans l’étude :
- adapter la mobilité (transports à la demande, covoiturage structuré, garages solidaires) ;
- rapprocher les formations (campus connectés, VAE renforcée, modules itinérants) ;
- mailler la garde d’enfants (micro-crèches, horaires atypiques) ;
- déployer des services « en aller-vers » (santé, droit, accompagnement social) ;
- sécuriser les trajectoires financières et patrimoniales (conseil, crédit, assurance) ;
- garantir une protection effective contre les violences (hébergements proches, plaintes confidentielles, relais formés).
Changer de regard pour changer d’échelle
Rendre visibles les femmes rurales n’est pas un supplément de discours, mais une condition de l’égalité réelle. Un pays ne peut prétendre avancer vers l’égalité femmes-hommes tout en laissant dans l’ombre un tiers de ses citoyennes, dont les réalités façonnent pourtant la majorité du territoire. La ruralité n’est ni un décor ni un « ailleurs » périphérique. Elle est l’un des espaces où se joue, avec la plus grande intensité, la capacité des Françaises à disposer de leur temps, de leur mobilité, de leurs droits, de leur sécurité et, au fond, de leur avenir.
Changer de regard, c’est reconnaître que l’égalité ne se mesure pas seulement dans les principes, mais dans les distances parcourues, les services accessibles, les choix ouverts ou refermés par la géographie. Changer d’échelle, c’est faire de ces réalités locales non pas une exception à traiter, mais un point de départ pour penser l’égalité partout.
« Je ne suis pas issue de la ruralité, j’appartiens à une terre chancelante et têtue. C’est elle qui parle à travers moi. Elle dit ce qui manque et ce qui existe encore. Elle dit ce qui meurt et ce qui survit. »
Juliette Rousseau
Introduction – Onze millions d’existences tenues hors champ :il nous faut lire les inégalités de genre depuis la ruralité
La ruralité a longtemps été pensée en creux, dans un jeu d’ombres où la ville et plus encore la capitale occupaient seules la pleine lumière. Jusqu’à il y a peu, les campagnes étaient ainsi décrites à travers le prisme de ce que la ville n’était pas ou n’avait pas – la tranquillité, les grands espaces, les traditions, le temps long… – ou bien à travers les supposés manques des campagnes – déficit d’infrastructures, pénurie d’emplois qualifiés, éloignement des services, atrophie de l’offre culturelle et éducative… Une « géographie du retard » structurait les représentations et guidait les politiques publiques, cantonnant les territoires peu denses à un rôle secondaire.
Depuis quelques années s’est esquissé un mouvement de rééquilibrage. Sous l’impulsion de travaux scientifiques renouvelés, d’initiatives associatives, de mobilisations locales et, plus abruptement, de secousses sociales comme le mouvement des Gilets jaunes, la ruralité est sortie de son invisibilité politique. Les médias s’y intéressent, les décideurs y cherchent des signaux faibles, la culture commence à se défaire de ses tropismes urbano-centrés. Les territoires, disait-on hier, étaient « oubliés » ; ils sont désormais considérés. Du moins un peu plus qu’avant.
Pourtant, ce frémissement ne suffit pas à combler les angles morts de plusieurs décennies. Les grilles d’analyse demeurent encore façonnées par des catégories de pensée urbaines. Elles appliquent encore aux campagnes et aux enjeux des 22 millions de Français qui les peuplent des cadres conçus ailleurs, pour d’autres réalités. Et lorsque l’on tente de comprendre, à l’échelle nationale, l’accès à l’emploi, à la santé, à l’éducation, au logement ou à la mobilité, la maille se détend : des « trous dans la raquette » apparaissent, révélant une complexité longtemps cachée par l’omniprésence métropolitaine.
C’est particulièrement le cas en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. À la difficulté d’appréhender les ruraux s’ajoute en effet une autre forme d’aveuglement, tout aussi persistante, celle qui touche la condition féminine. La France entend volontiers se décrire comme un pays qui progresse vers davantage de justice de genre. Il est vrai que le débat public s’est élargi, que la parole s’est libérée, bousculant certitudes et hiérarchies. L’égalité femmes-hommes a même été élevée au rang de grande cause nationale du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Mais, une fois encore, ces victoires féministes gagnées plus qu’obtenues, ont été largement conçues depuis les espaces urbains. Là où se concentrent les relais d’opinion, les carrières ascendantes et les ressources militantes. Sans que se pose réellement la question de leurs réels effets à la campagne.
Bien entendu, les rurales n’ont pas attendu le grand soir pour s’organiser, pour revendiquer une situation plus égalitaire, pour monter des réseaux de solidarité entre femmes, des associations locales d’entraide ou de mise à l’abri. Mais les financements, les cadres, les ressources humaines qui sous-tendent leur capacité d’action et le soutien sur lesquels elles peuvent compter passent trop souvent à côté des rurales et de leurs réalités quotidiennes.
Or un tiers des femmes de France vivent en ruralité. Elles représentent 11 millions de citoyennes réparties sur 91,5 % du territoire national. Ces femmes a iment leur territoire, le connaissent souvent dans toutes ses nuances et ses ambivalences. Elles travaillent, entreprennent, élèvent des enfants, s’engagent dans la vie associative et politique locale. Elles contribuent à la cohésion sociale, au développement économique, à la vitalité démocratique du pays. Mais leur vécu demeure largement absent des récits nationaux. Peu de données, peu d’indicateurs, peu de représentations. Une invisibilisation d’autant plus forte qu’elle résulte de deux processus cumulatifs : une moindre attention portée aux femmes et une moindre attention portée aux territoires ruraux. Un effet de « double marge » qui pèse lourd dans la construction des trajectoires de vie.
Car les inégalités de genre ne se jouent pas seulement en termes d’opportunités symboliques disponibles ou inaccessibles. Elles se vivent aussi en termes de niveau de vie, s’observent dans les charges assumées, se cristallisent dans la capacité à emprunter ou investir. Sur tous ces aspects, la ruralité agit comme un amplificateur d’inégalités. Dans ces territoires où les revenus sont structurellement plus faibles et les dépenses alourdies par les frais de transport, la moindre marge de manoeuvre se transforme vite en renoncement matériel : heures de travail réduites, formations jugées trop coûteuses ou trop lointaines, opportunités professionnelles réduites… Le reste à vivre, indicateur central des conditions réelles d’existence, se construit différemment selon l’endroit où l’on habite. Et pèse différemment selon que l’on est femme ou homme.
Ainsi, chaque recul d’un service essentiel – crèche, halte-garderie, bus, guichet administratif, cabinet médical… – produit un effet genré. Faute d’alternative, ce sont souvent les femmes qui absorbent les démarches, les distances, les imprévus. Et toute la charge mentale qui en découle. Ce sont elles qui réorganisent le quotidien, adaptent leurs horaires, renoncent. Non parce que les femmes rurales seraient naturellement plus disponibles. Mais parce que l’architecture territoriale produit des contraintes qui se répercutent d’abord sur elles, patriarcat oblige.
Ces dynamiques traversent toutes les sphères de la vie sociale. Là où les bassins d’emploi sont restreints, où les formations sont éloignées, où les réseaux de transports sont insuffisants et les connexions professionnelles peu denses, les femmes disposent de moins de marges de manoeuvre. Il ne s’agit pas seulement d’obstacles, mais de ce que la théorie des capabilités nomme des « restrictions d’opportunités réelles » : distance, coût, temps, charge logistique, capacité à financer un déplacement ou un projet. Ce sont là des arbitrages constants, entre l’entretien trop éloigné, la formation hors de portée ou l’opportunité incompatible avec les horaires du foyer et l’absence de transports en commun.
Comprendre la condition féminine en France suppose donc d’accepter de déplacer son regard, d’intégrer les femmes rurales dès lors que l’on entend faire advenir une égalité femmes-hommes. Car les rurales affrontent les mêmes inégalités structurelles que les femmes urbaines, mais dans un contexte où chaque difficulté pèse davantage, matériellement, financièrement et temporellement. Certaines expriment un fort attachement à leur territoire, à leur rôle, à leur autonomie. Mais aussi une forme de « compromis rural1Voir Destin commun-Bouge ton coQ-inSite-Rura, Paroles de campagne. Réalités et imaginaires de la ruralité française, juin 2025. », ajustement permanent entre la vie qu’on choisit et le coût qu’elle impose. Coût en énergie, en temps, en mobilité, en sommeil, parfois en santé, souvent en pouvoir d’agir économique. Coût très largement assumé par les femmes.
Documenter ces réalités, c’est redonner voix et visibilité à des trajectoires discrètes, mais décisives et résolument nombreuses. C’est montrer que les inégalités de genre ne prennent pas la même forme selon l’endroit où l’on vit. C’est interroger ce que deviennent les ambitions, les marges de liberté, les capacités économiques, lorsque les distances, les ressources, les services et les réseaux structurent étroitement le champ des possibles.
De ces constats, trois lignes de force se dégagent. D’abord, les femmes qui vivent en ruralité ne forment pas un groupe à part. Elles sont exposées aux mêmes mécanismes de domination que l’ensemble des femmes du pays. Mais ces dynamiques prennent une intensité particulière lorsqu’elles se combinent aux réalités matérielles propres aux campagnes.
Ensuite, la ruralité n’est jamais un simple décor. Elle façonne les parcours. Elle infléchit les ambitions, les opportunités, les niveaux de vie, le rapport au travail, à l’autonomie, au capital économique. Du début de l’âge adulte aux derniers temps de la vie, en passant par l’entrée dans la vie active ou la maternité, chaque étape de la vie des femmes rurales est modulée par des dynamiques, des impossibilités, des attendus, qui façonnent les trajectoires et fondent les inégalités.
Enfin, aucune politique d’émancipation ne peut prétendre s’adresser à « toutes les femmes » si elle ignore tout ou partie de celles qui vivent dans les campagnes. Les laisser à la marge, ce n’est pas seulement négliger une fraction conséquente de la population. C’est aussi se priver d’une compréhension essentielle de la condition féminine contemporaine et être condamné à produire des solutions qui n’atteindront jamais l’ensemble du pays.
L’étude que nous présentons s’appuie sur une production inédite de données, sur une analyse comparative solide et sur l’expertise territoriale de l’Institut Terram et de Rura. Elle ambitionne de sortir la condition féminine rurale de l’impensé national, de mettre à jour les réalités matérielles de leur existence et de proposer des clés d’action à la hauteur d’un enjeu trop longtemps laissé dans l’ombre.
Il va sans dire que les situations d’empêchement ne concernent pas l’ensemble des femmes rurales. Certaines ne s’y reconnaîtraient pas, tout comme, en France, certaines femmes n’ont jamais été confrontées à des violences, à des inégalités salariales ou à des formes de sexisme ordinaire. Pour autant, lorsqu’une inégalité est systémique, une société qui se veut garante des mêmes droits pour toutes et tous doit se référer aux situations les plus défavorables afin d’y répondre de manière réellement efficace.
Méthodologie
Pour saisir la complexité des trajectoires féminines en ruralité, l’étude s’appuie sur une approche mixte, articulant un volet quantitatif d’ampleur et un volet qualitatif approfondi. Cette combinaison permet d’objectiver les écarts et les conditions matérielles, tout en donnant accès aux expériences vécues, aux arbitrages du quotidien et aux représentations intimes que les chiffres seuls ne peuvent restituer.
Un dispositif quantitatif robuste
L’enquête a été menée auprès de 5 052 personnes âgées de 18 ans et plus, constituant un échantillon représentatif de la population française adulte. Selon la grille communale de densité de l’Insee, les espaces ruraux regroupent environ un tiers des Français majeurs, ce qui permet, au sein de l’échantillon, de disposer d’un sous-groupe de 1 660 répondants vivant en ruralité. Parce que l’objet de l’étude est centré sur les femmes rurales, un suréchantillon dédié a été constitué : 1 016 femmes âgées de 18 ans et plus résidant en zone rurale ont été interrogées, avant d’être réintégrées selon leur poids réel par un redressement statistique. L’échantillon a été établi selon la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, type de territoire et région), et l’ensemble des répondants a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI) entre le 26 septembre et le 1er octobre 2025.
Pour affiner l’analyse territoriale, plusieurs typologies issues de l’open data ont été mobilisées :
- la classification Insee, qui distingue trois grands types d’espaces selon leur densité : urbain dense, urbain intermédiaire et rural ;
- la grille Eurostat-OCDE, qui apporte une lecture plus détaillée en sept catégories, allant des grands centres urbains jusqu’aux zones rurales à habitat très dispersé ;
- la typologie des ruralités élaborée par l’ANCT, qui permet d’identifier les petites polarités rurales, les ruralités productives, les ruralités résidentielles ou encore les ruralités touristiques ;
- enfin, la définition des unités urbaines par l’Insee, fondée sur la continuité du bâti, qui distingue les communes isolées, les petites et moyennes agglomérations, les grandes agglomérations hors Paris ainsi que l’agglomération parisienne.
L’exploitation combinée de ces référentiels permet de situer finement chaque répondant dans son environnement de vie2Il convient de souligner que les données disponibles et les travaux existants ne permettent pas, à ce stade, d’élaborer une analyse spécifique des couples non hétérosexuels. Une étude complémentaire portant sur l’ensemble des femmes rurales dont les trajectoires ne s’inscrivent pas dans des cadres conjugaux hétéronormés serait particulièrement pertinente. et d’éclairer les effets propres à chaque configuration territoriale.
Un volet qualitatif pour mettre en récit les réalités vécues
En aval de l’enquête quantitative, un échantillon de 93 femmes vivant en zone rurale a été interrogé qualitativement. Toutes avaient participé au volet quantitatif de l’étude et ont accepté de participer à un entretien. Cet échantillon ne prétend pas être représentatif de l’ensemble des femmes rurales, mais il a été construit pour refléter une diversité d’expériences en termes d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de type de territoire, de revenus du foyer et de situation familiale. Les entretiens se sont déroulés du 6 au 8 octobre 2025. Les participantes ont été interrogées via un chatbot conversationnel IAChat.
Les femmes rurales et le syndrome Manon des sources
1. Au-delà des poncifs, qui sont les rurales ?
a/ Une réalité sociale plurielle : rompre avecla fiction homogène de la « femme rurale »
Dans les discours publics comme dans nombre de travaux académiques, les femmes rurales constituent un groupe souvent évoqué mais rarement décrit avec précision. Si ces dernières années un certain nombre de travaux de sociologie sont venus étoffer la compréhension collective des femmes rurales, ces travaux ont majoritairement été centrés sur des approches qualitatives, ciblés par tranche d’âges ou ancrés dans un territoire en particulier. À l’échelle nationale, les données statistiques et les analyses quantitatives qui traitent des femmes des campagnes sont encore rares. Celles-ci représentent pourtant 11 millions de personnes, soit un tiers des femmes de France.
Cette lacune de données et d’analyses quantitatives limite la capacité collective à décrire, à structurer et à comprendre avec finesse les enjeux des femmes rurales, population socialement hétérogène, répartie sur les 91,5 % du territoire et les 30 775 communes que constitue la ruralité. En outre, l’atrophie de données et de récits disponibles conduit à une mauvaise représentation de ces femmes rurales. Dès lors, l’imaginaire collectif, par un réflexe pavlovien bien connu, se tourne vers les représentations disponibles, continuant à figer celles-ci en une figure ancienne, celle de l’épouse d’agriculteur, silhouette laborieuse, taiseuse, à l’écart des dynamiques sociales. Si elle s’est imposée, cette image ne résiste pas une seconde à un examen empirique. Les données de notre enquête montrent au contraire l’existence d’un ensemble composite et diversifié de femmes rurales, dont les caractéristiques contredisent la vision traditionnelle d’un groupe social homogène.
La première singularité des femmes rurales tient à la structure d’âge. Selon l’Insee, elles sont en moyenne plus âgées que les urbaines : 39 % ont plus de 60 ans, contre 34 % en ville, tandis que seules 12 % d’entre elles ont moins de 30 ans, contre 19 % en milieu urbain. Cette surreprésentation des générations plus âgées n’est pas marginale. Elle renvoie à une tendance structurelle de la démographie rurale, marquée par le vieillissement et par le départ d’une portion non négligeable de la jeunesse rurale au moment de poursuivre ses études, les opportunités académiques étant massivement concentrées dans les grandes métropoles. Ces données démographiques rappellent surtout que l’expérience féminine de la ruralité n’a rien de monolithique. Elle s’inscrit dans des cycles de vie où les questions de mobilité, d’emploi, d’autonomie financière et de sécurité économique se posent différemment selon les âges. Pour beaucoup de femmes retraitées, la question du revenu, souvent indexé sur des carrières incomplètes ou des statuts non reconnus, demeure centrale dans la façon d’habiter ces territoires.
La diversité socioprofessionnelle vient renforcer cette pluralité. Un tiers des femmes rurales (32 %) relèvent des catégories socioprofessionnelles inférieures (CSP–), proportion identique à celle des femmes urbaines. Près d’une sur quatre (23 %) appartiennent aux catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+), un niveau cette fois inférieur à celui des urbaines (27 %). Derrière ces proportions, on doit projeter la variété des emplois existants dans les territoires ruraux, des enseignantes, des infirmières, des cadres administratives, des artisanes, des professions intermédiaires ou des entrepreneures, dont les réalités de travail diffèrent profondément de la figure stéréotypée de l’agricultrice qui, elle, ne représente in fine que 119 000 personnes sur les 11 millions de femmes rurales3« En 2022, la population active non-salariée agricole féminine se compose de 103 854 cheffes et 14 987 collaboratrices d’exploitation, soit un total de près de 118 841 femmes » (Mutualité sociale agricole-MSA, « Info stat. Les femmes dans le monde agricole en 2022 », 2024)..
Les inactives, elles, représentent 45 % des femmes rurales – une proportion identique à celle des urbaines, mais bien supérieure à celle des hommes (38 % des ruraux, 36 % des urbains). Cette proportion ne reflète pas une absence de participation à l’activité économique, mais témoigne plutôt d’empêchements en série tout au long de la vie des femmes rurales, où se succèdent en proportion très importante : temps partiels, contrats précaires et de courte durée, carrières discontinues, souvent liées aux responsabilités familiales, à une organisation patriarcale poussant les femmes plutôt que les hommes à se concentrer sur l’organisation de leur foyer, ou encore à la faiblesse de l’offre d’emploi local.
Enfin, les femmes rurales habitent dans des territoires ruraux variés. Elles sont ainsi réparties de manière presque équivalente entre bourgs ruraux (47 %) et habitat dispersé (45 %). Seules 8 % d’entre elles résident dans un habitat très dispersé.
À l’inverse de l’image qui a longtemps persisté de femmes rurales évoluant dans des pâturages verdoyants, entre activités d’artisanat et promenades en forêt, les rurales ont des réalités quotidiennes variées, au sein de territoires qui le sont autant, tout comme les attachements divers dont elles témoignent à l’égard du lieu où elles vivent.
b/ « La femme rurale » : entre essentialisation, exotisation et effacement politique
Si les femmes rurales sont si peu identifiées dans leur complexité, c’est que leur représentation repose sur un ensemble d’images préconçues et de filtres symboliques construits et diffusés par d’autres qu’elles. Ces biais témoignent plus des fantasmes de ceux qui tiennent la plume, le micro ou la caméra, que de la réalité quotidienne des femmes rurales. En découlent des représentations en creux, essentialisantes, voire exotisantes, qui associent ruralité féminine, tradition et simplicité. Cette déconnexion du réel rend les femmes rurales invisibles politiquement. Elle masque les déterminismes sociaux, territoriaux et de genre qui, trop souvent, affectent les trajectoires de millions de femmes.
L’essentialisation féminine des campagnes s’appuie sur un répertoire esthétique profondément enraciné, qui traverse la littérature, la peinture, le cinéma, la photographie, la publicité et, désormais, la mode. La femme rurale y apparaît moins comme un sujet que comme une figure symbolique, un motif visuel et moral au service d’une vision fantasmée et consommable de la ruralité.
Dans la littérature du xixe siècle, par exemple, on pense à la façon dont Émile Zola fixe durablement les contours de la femme rurale dans La Terre (1887). La femme y est inscrite dans un univers de filiation et de reproduction sociale où son rôle est assigné : gardienne du foyer, force de travail silencieuse, maillon familial plus qu’individu à part entière. Elle y est une auxiliaire à la narration et au destin des autres. Guy de Maupassant, dans Toine (1885), dans Une vie (1883) ou dans ses nouvelles campagnardes, prolonge cette perspective. La femme rurale y est façonnée par la rudesse du quotidien, condamnée à une forme de résignation pratique qui tient lieu d’horizon. Si, dans ses romans champêtres, George Sand semble ouvrir une brèche, proposant des héroïnes dotées d’une certaine capacité d’agir, cette réhabilitation passe toutefois par une idéalisation morale faite de pureté, de douceur et de dévouement.
La peinture du xixe siècle consolide elle aussi ce répertoire. Des oeuvres comme L’Angélus (1857) ou Les Glaneuses (1857) de Jean-François Millet ou encore La Petite Bergère (1889) de Jules Bastien-Lepage mettent en scène des figures féminines paysannes saisies dans des postures de labeur silencieux et de douceur pastorale. Ces toiles ont ancré l’idée d’une femme rurale associée à l’effort physique ou moral, à l’innocence, à la soumission et à une forme de naturalité qui ferait d’elle la garante d’un lien organique entre humanité et nature. La ruralité féminine y devient une allégorie, un refuge imaginaire où se logerait une France intemporelle. Une « arche » patrimoniale, bien plus fantasmée que réelle.
Le théâtre et le cinéma ont aussi amplifié et diffusé cette construction. Le film L’Aurore (1927), de F.W. Murnau, est ainsi un film majeur pour penser non seulement la figure de la femme rurale mais aussi son opposition systématique avec celle de la femme urbaine. Cette dernière apparaît comme une séductrice indépendante et désirable, promesse de chaos dans un foyer rural jusqu’alors uni. La grande ville est associée à la corruption morale et la femme urbaine en est l’incarnation. Dans ce contexte, la figure féminine rurale, toute aussi blonde que son antagoniste est brune, apparaît bien sûr douce, silencieuse, vulnérable, proche de la nature et dévouée à son mari. À la fois moralisée et idéalisée. Dans une autre veine, le cycle provençal de Marcel Pagnol puis les réécritures filmées qui en ont été faites ont installé au coeur de l’imaginaire collectif une femme rurale à la beauté sauvage, enracinée, sacrificielle. Le cinéma contemporain, lui, a rarement rompu avec cette tradition. Dans Les Gardiennes (Xavier Beauvois, 2017), les femmes qui travaillent aux champs pendant la Première Guerre mondiale sont représentées à travers une esthétique de la terre et du devoir. Dans Seules les bêtes (Dominik Moll, 2019), la ruralité agit comme une force qui conditionne les affects et les moralités féminines, absorbant les destins individuels. Même les démarches documentaires, telle La Vie moderne (Raymond Depardon, 2008), qui filme avec une intensité rare les exploitations isolées du Massif central, montrent des femmes dont la centralité économique est indéniable mais qui demeurent souvent hors champ, en retrait de la narration. Cette mise à distance des femmes rurales du coeur des trames narratives et des mécaniques qu’elles subissent contribue à produire une figure féminine dépolitisée, désintéressée, dépouillée des enjeux de pouvoirs et des défis matériels.
Ces couches successives de représentations littéraires, picturales et cinématographiques constituent une matrice culturelle puissante. Elles ne se limitent pas au passé, mais irriguent encore largement la culture visuelle contemporaine. Les campagnes de mode en sont l’une des traductions les plus récentes et explicites. Les images et les thèmes mobilisés par la marque de vêtements Jacquemus, comme dans les champs de blés du Val-d’Oise ou de lavande en Provence, orchestrent ainsi une ruralité hyperstylisée. Pour sa dernière collection (Le Paysan, 2025), la marque présente même des reconstitutions de scènes rurales tirées d’albums de famille du fondateur de la marque : récolte, marché, vie de famille… Le défilé de la collection au château de Versailles va jusqu’à mettre en scène un paysan idéalisé, épuré, à la fois rustique et sophistiqué. Vidé de sa substance, il n’est plus qu’une image écran, un décor, propre à la consommation. Des marques de prêt-à-porter comme Sézane ou Rouje s’approprient également ces codes : coquelicots, chemins de terre, nappe vichy, bicyclette et douceur d’été, promesse d’authenticité… Les Parisiennes en recherche de ces promesses marketing peuvent ainsi porter des attributs de jeunes rurales idéalisées. Même certains secteurs plus inattendus, la cosmétique, l’ameublement ou l’agroalimentaire, recyclent cette esthétique d’une ruralité douce, simple et apaisée où la femme virevolte ou s’alanguit plus qu’elle n’agit.
Cette distorsion symbolique a des implications politiques directes. Une catégorie sociale réduite à des images hors-sol est plus difficile à saisir ou à protéger. L’invisibilisation des femmes rurales n’est pas seulement culturelle, elle est aussi institutionnelle. Parce qu’on les imagine unidimensionnelles, on ne peut distinguer clairement les inégalités qu’elles affrontent. Leur faible visibilité symbolique nourrit leur faible visibilité statistique et politique. Cette invisibilité alimente de facto l’inaction à leur endroit et, en retour, la reproduction des inégalités matérielles qu’elles subissent.
c/ L’expérience de la ruralité au quotidien dessine une condition féminine rurale
Si les femmes rurales présentent des profils sociaux et professionnels hétérogènes, leur expérience quotidienne est néanmoins structurée par un ensemble de contraintes communes. Ces points communs sont beaucoup moins liés à leur position sociale qu’à la nature même des territoires qu’elles habitent. La ruralité n’est pas seulement un paysage. C’est une organisation géographique, où la faible densité éloigne les femmes des lieux et des opportunités. Si, en ruralité, 1 kilomètre = 1 minute, les ruraux, et singulièrement les rurales, partagent une condition commune, façonnée par la faible densité, l’éloignement des opportunités, la rareté des services, l’impératif de mobilité individuelle et le temps nécessaire à lui consacrer. Quelle que soit leur situation professionnelle, les habitantes des zones peu denses évoluent dans des espaces où la dispersion spatiale des activités limite structurellement les options disponibles. Ce n’est pas tant le nombre d’équipements qui manque que leur accessibilité. Cette condition commune crée ce que l’on pourrait nommer une « communauté d’expériences » qui, faute de prise en compte et de compensation, devient une communauté de destins. Finalement, ce sont moins les paysages, pourtant très divers, que cette grammaire commune de la distance et de la dispersion qui unifie l’expérience des femmes rurales.
Toutefois, cette communauté d’expériences ne doit pas masquer une autre forme de communauté, plus large encore : celle qui unit les femmes entre elles, indépendamment du lieu où elles habitent. Comme le montre à bien des égards notre étude, les inégalités de genre qui pèsent sur les femmes rurales sont globalement les mêmes que celles qui affectent les femmes urbaines.
2. De Mirecourt à Villeurbanne en passant par le coeur du Havre : femmes rurales, femmes urbaines, mêmes combats
a/ Le non-partage du travail domestique : un invariant territorial
Si les mouvements féministes successifs ont profondément transformé les droits et les représentations des femmes, la société française demeure un régime d’égalité inachevée. Ce qui frappe à la lecture de nos données, c’est la stabilité transversale des mécanismes de domination que rencontrent les femmes.
Cet état de fait ne semble pas connaître de frontières géographiques. Les inégalités entre les femmes et les hommes se retrouvent partout, au coeur des grandes villes, des banlieues, comme des villages et des hameaux. Ce constat rejoint l’idée développée par Pierre Bourdieu selon laquelle les rapports de genre constituent une structure structurée et structurante4Voir Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, Paris, Éditions de Minuit, 1980., capable de se recomposer dans des contextes très différents, sans perdre son efficacité. On retrouve également ici la grille proposée par la philosophe Nancy Fraser, qui distingue les deux versants des injustices de genre : la redistribution, c’est-à-dire la manière dont les ressources, le temps et les positions sociales sont répartis, et la reconnaissance, c’est-à-dire la valeur symbolique attribuée aux identités, aux pratiques et aux rôles5Voir Nancy Fraser, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et distribution, Paris, La Découverte, 2005.. La ruralité et l’urbanité modifient les formes d’expression de ces injustices, mais ne changent pas leur nature profonde. Ce qui fait évoluer le territoire, ce ne sont pas tant les inégalités de genre elles-mêmes que la manière dont elles s’inscrivent dans la vie quotidienne, les opportunités disponibles, les arbitrages possibles et les chaînes de dépendance qui structurent les existences.
La matrice de ces inégalités demeure le non-partage des tâches domestiques et parentales. C’est cette asymétrie, fondatrice, qui rejaillit sur la plupart des autres. La sociologue Arlie Hochschild l’a formulé dès 1989 avec le concept de « seconde journée » : avant et après le travail rémunéré s’ouvre pour les femmes une autre séquence de travail invisible, faite d’organisation, d’anticipation et de responsabilités morales envers le foyer6Voir Arlie Hochschild et Anne Machung, The Second Shift. Working Families and the Revolution at Home, New York, Penguin Books, 2012.. Cette charge opérationnelle et mentale, ce travail invisible « à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence7Nicole Brais, cité in « Dialogues économiques. La charge mentale, une double peine pour les femmes », lejournal.cnrs.fr, 4 mars 2021. », reste l’un des angles morts les plus massifs des politiques publiques. L’Observatoire des inégalités en offre une confirmation implacable : depuis 2003, le partage des tâches domestiques et familiales ne progresse pas. Il semble au point mort8Observatoire des inégalités, 2020..
Les données de notre étude en fournissent une illustration concrète. Les femmes sont moins de 4 % à estimer que leur conjoint en fait davantage qu’elles à la maison (4 % en milieu urbain, 3 % en ruralité). À l’inverse, 18 % des hommes, quel que soit leur territoire d’ancrage, estiment faire plus que leur conjointe. Ce décalage de perception révèle un mécanisme central de reproduction des inégalités, à savoir la banalisation du travail féminin jusqu’à le rendre « naturel » et la désintégration cognitive et symbolique de la contribution féminine dans la division du travail domestique.
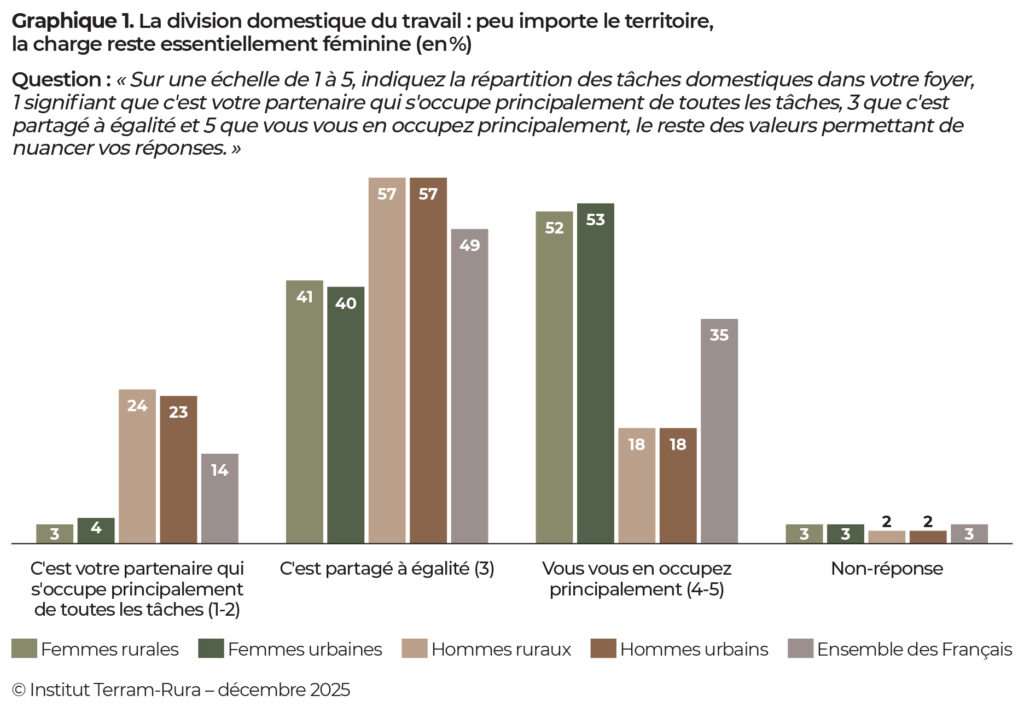
b/ La sécurité économique : un sentiment genré avant d’être géographique
Une autre dimension qui rapproche fortement les femmes, indépendamment de leur lieu de vie, est celle de la sécurité économique, entendue comme la capacité à mener son existence sans être exposée à des risques financiers susceptibles d’entamer son autonomie. On pourrait imaginer que les différences territoriales – structure sectorielle de l’emploi, densité des services, diversité des opportunités professionnelles… – produisent des effets contrastés entre femmes rurales et urbaines. Or les données contredisent ce présupposé : 53 % des femmes rurales déclarent ne pas se sentir en sécurité économique, soit 3 points de plus que les femmes urbaines (50 %). L’écart se joue ailleurs, du côté des hommes, beaucoup moins nombreux à exprimer cette insécurité (38 % des ruraux, 37 % des urbains).
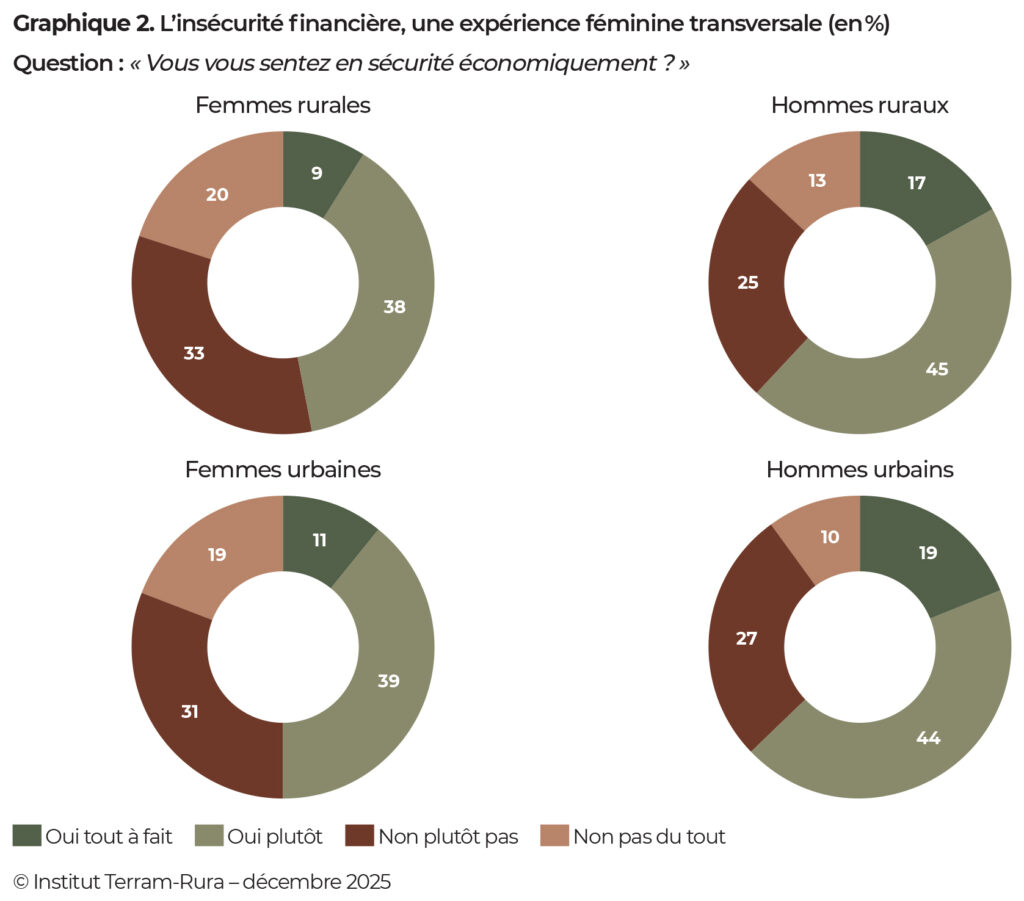
En France, entre 1998 et 2015, l’écart de patrimoine entre les femmes et les hommes est passé de 9 à 16 %9Voir Nicolas Frémeaux et Marion Leturcq, « Inequalities and the individualization of wealth », Journal of Public Economics, vol. 184, avril 2020, article 104145.. Il a donc quasiment doublé. Les représentations culturelles associant la féminité au don, à la gratuité et à la disponibilité – et la masculinité au pouvoir, au revenu et au patrimoine – irriguent encore largement les pratiques familiales, les politiques fiscales et les trajectoires professionnelles10Voir Titiou Lecoq, Le Couple et l’Argent. Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes, Paris, L’Iconoclaste, 2022.. C’est ainsi que les inégalités économiques se nourrissent des inégalités domestiques et symboliques.
L’un des facteurs qui alimente le sentiment d’insécurité économique des femmes est leur capacité plus limitée à épargner. Un constat qui vaut autant en ville qu’à la campagne : 40 % des femmes rurales et 41 % des femmes urbaines déclarent pouvoir mettre de l’argent de côté chaque mois, loin derrière les hommes (54 % des urbains, 55 % des ruraux). Lorsque l’on examine plus finement les montants réellement mis de côté chaque mois, un schéma similaire apparaît. Femmes rurales et femmes urbaines déclarent, dans des proportions quasiment identiques, n’épargner que de très petites sommes, le plus souvent moins de 100 euros par mois. À l’inverse, les hommes sont nettement moins concernés par cette épargne minimaliste et parviennent plus fréquemment à mettre de côté des montants plus élevés. Ce résultat peut sembler contre-intuitif si l’on pense les conditions économiques uniquement à partir du type d’emploi ou du territoire, mais il montre bien que, dans la capacité à dégager une marge financière, le poids du genre l’emporte sur l’effet du lieu de vie.
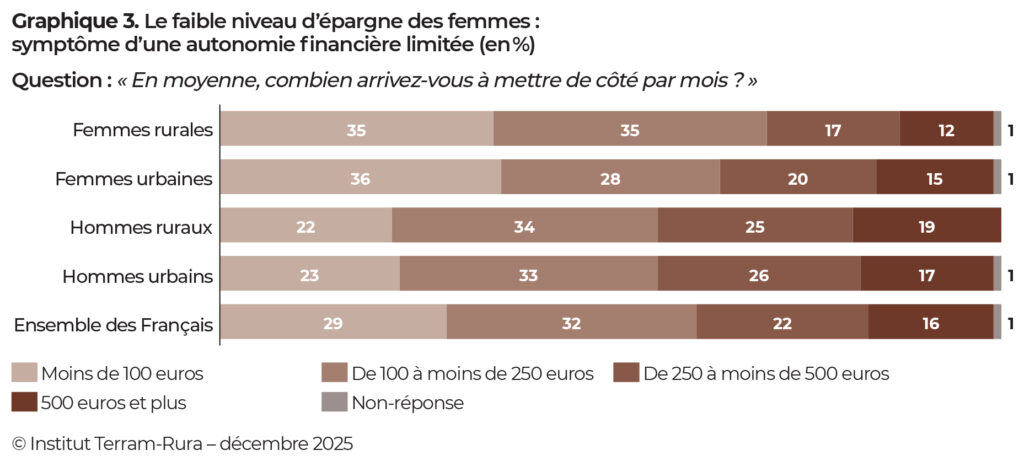
Mêmes similitudes genrées pour l’endettement et le fait de devoir prendre sur son épargne : un quart des femmes rurales (27 %) et urbaines (24 %) dépensent chaque mois davantage qu’elles ne gagnent, quand les hommes ne sont que 17 % (ruraux) et 16 % (urbains) dans cette situation. C’est ainsi que les femmes assument une part disproportionnée des arbitrages financiers du foyer, alors qu’elles disposent souvent de revenus plus fragmentés, plus bas et plus précaires.
c/ Comment le genre balise les trajectoires professionnelles
Dès les premières bifurcations scolaires, les femmes, en ruralité ou en milieu urbain, décrivent la force d’une assignation initiale liée à leur genre. Cette assignation infléchit leurs choix, avant même que ne se déploient les effets des milieux sociaux ou des contextes territoriaux. Près d’une femme sur deux déclare ainsi que son orientation ou sa trajectoire professionnelle a été limitée du fait même d’être une femme.
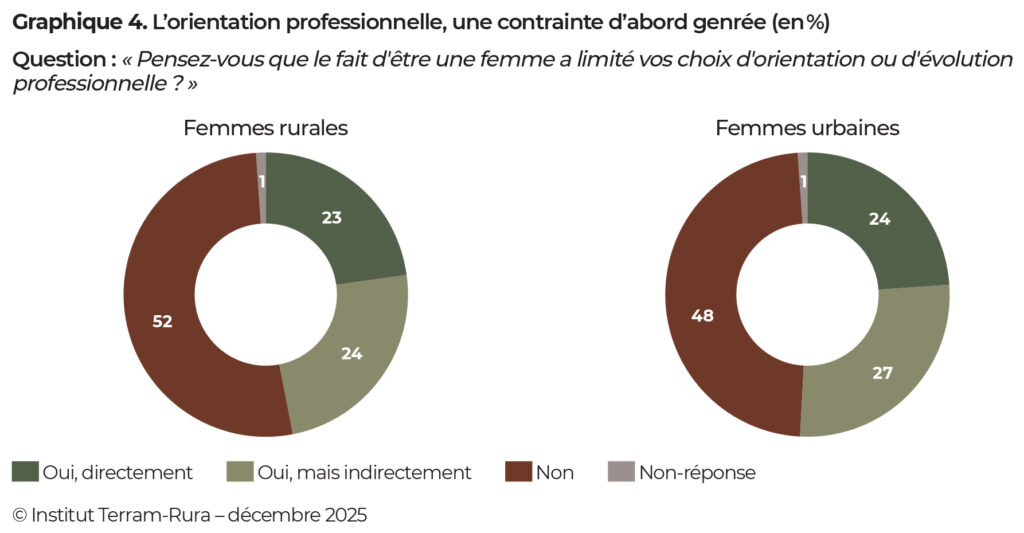
Ce qui frappe, dans l’ensemble des réponses recueillies, c’est la constance avec laquelle les femmes identifient le genre comme le premier facteur pesant sur leur parcours. Cette primauté n’est pas modulée par le niveau de diplôme, le revenu ou le lieu de vie. Elle traverse toutes les catégories. Lorsque les femmes hiérarchisent les contraintes qui ont pesé sur leur trajectoire, le genre apparaît comme la variable structurante, celle qui précède les autres et les organise.
Lorsque les femmes sont sondées sur leurs trajectoires professionnelles, les conséquences en chaîne apparaissent distinctement. Une proportion significativement plus importante de femmes rurales (31 %) comme urbaines (29 %) dit ne pas se sentir libre dans ses choix de carrière (contre 24 % pour les hommes ruraux et 23 % pour les hommes urbains). Le même alignement apparaît dans la satisfaction au travail, avec des femmes qui expriment un niveau de satisfaction inférieur à celui des hommes : 34 % des rurales et 35 % des urbaines se disent ainsi insatisfaites, contre un quart des hommes tous territoires confondus.
Enfin, lorsque l’on interroge leur optimisme professionnel, 58 % des femmes rurales comme urbaines se déclarent confiantes. Les hommes ruraux, quant à eux, affichent un niveau d’optimisme nettement moindre que les hommes urbains (61 % contre 69 %), au point de se rapprocher de celui des femmes. Ce resserrement, inhabituel, suggère que certaines contraintes propres aux zones peu denses peuvent également peser sur les hommes.
d/ La liberté sous contrainte
Lorsque l’on quitte la sphère professionnelle pour interroger la vie personnelle, le même parallélisme s’impose. Les femmes rurales et urbaines sont, dans les deux cas, 23 % à déclarer ne pas se sentir pleinement libres dans leur vie privée. C’est 6 points de plus que les hommes, urbains comme ruraux (17 %). Comment en serait-il autrement ? L’autonomie financière et la position professionnelle constituent des leviers essentiels de la liberté conjugale. Moins de ressources propres, moins de marges de manoeuvre, moins de sécurité économique, moins de capacité à décider pour soi, qu’il s’agisse de négocier le quotidien, d’imposer ses choix ou d’envisager, le cas échéant, une séparation. Les écarts ressentis dans la vie intime prolongent mécaniquement ces déséquilibres. Ainsi, 16 % des femmes rurales mariées et 20 % des femmes urbaines mariées déclarent se sentir souvent peu écoutées au sein de leur famille. Là encore, l’écart avec les hommes est frappant : seuls 8 % des ruraux et 11 % des urbains rapportent cette expérience.
Pour comprendre cette dissymétrie, l’analyse de l’éthique du care semble particulièrement adaptée. Nos sociétés reposent sur une véritable politique de l’attention, c’est-à-dire sur la manière dont nous distribuons l’écoute, la considération et la crédibilité11Voir Sandra Laugier, « L’éthique comme politique de l’ordinaire », Multitudes, n° 37-38, automne 2009, p. 80-88.. Dans l’espace domestique, certaines voix sont spontanément perçues comme légitimes, d’autres reléguées à l’arrière-plan. Il ne s’agit pas d’une intentionnalité malveillante, mais d’une organisation symbolique ancienne et patriarcale qui hiérarchise les besoins et les paroles. Les données convergent : les femmes, où qu’elles vivent, demeurent plus exposées à cette inégalité de réception, qui façonne profondément leur sentiment de liberté et de reconnaissance au sein du couple. Ce n’est donc pas un hasard si l’accumulation de ces inégalités, petites ou grandes, produit chez les femmes le sentiment de ne pas être reconnues à leur juste valeur. Ce déficit de reconnaissance, forme de dévalorisation sociale, s’ajoute aux inégalités matérielles, voire les renforce.
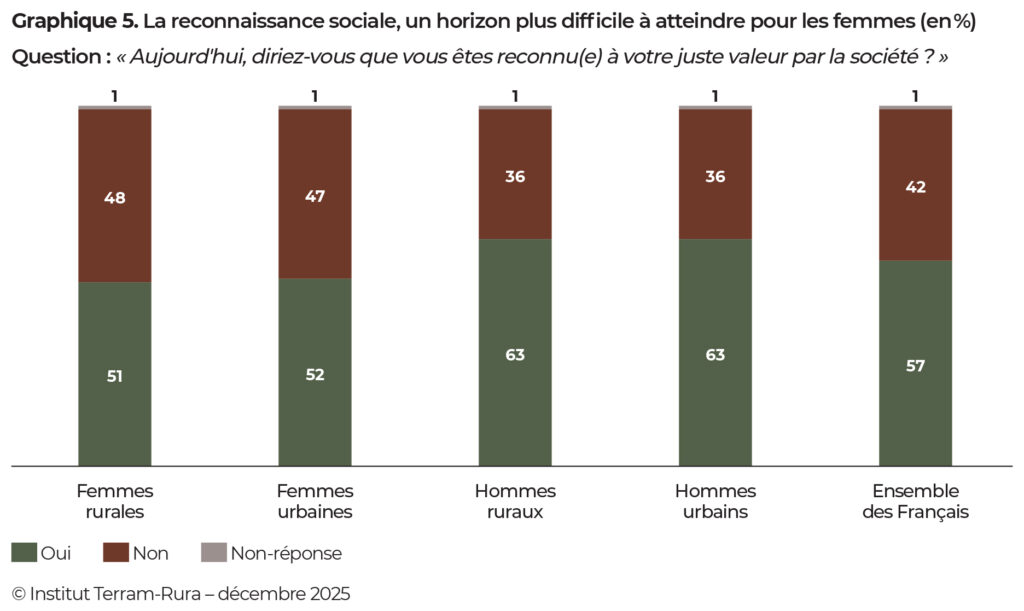
L’ensemble de ces données fait état d’inégalités de genre qui agissent comme des charges cumulatives. Des contraintes successives qui, superposées les unes aux autres, finissent par peser durablement sur les femmes. Les effets de ces tensions ne demeurent pas circonscrits à la sphère sociale et s’incarnent aussi dans la santé psychique. Ainsi les femmes sont-elles 71 % en ruralité et 73 % en ville à déclarer rencontrer des situations psychologiques difficiles, contre 56 % pour les hommes ruraux et 59 % pour les hommes urbains. La « fatigue d’être soi » décrite par Alain Ehrenberg12Voir Alain Ehrenberg, La Fatigue d’être soi. Dépression et société, Paris, Odile Jacob, 1998. trouve ici une traduction genrée : lorsque les responsabilités domestiques, professionnelles, familiales et organisationnelles s’additionnent, lorsque vos écosystèmes de proximité ne vous accordent pas une écoute suffisante, lorsque ces souffrances du quotidien ne sont pas reconnues à leur juste valeur, la charge mentale se transforme en charge émotionnelle et celle-ci en vulnérabilité psychologique13Voir Victor Delage, Margaux Tellier-Poulain et Lou Vincent, Santé mentale des jeunes de l’Hexagone aux Outre-mer, Institut Terram-Institut Montaigne-Mutualité française, septembre 2025..
3. « Malus rural du genre » : si le genre crée l’inégalité, le territoire l’amplifie
a/ Une charge domestique amplifiée par les contraintes territoriales
Si les femmes expérimentent les mêmes inégalités de genre, souvent dans des proportions similaires, une dimension supplémentaire, cette fois territoriale, apparaît immédiatement à l’analyse des données : l’écart entre les femmes et les hommes est presque toujours plus marqué en ruralité qu’en milieu urbain. En d’autres mots, le genre structure les trajectoires partout, mais il le fait plus durement dans les espaces peu denses. Le différentiel n’est pas seulement statistique ; il signe ce que la sociologie appelle un « effet de contexte », où un même rapport social produit des conséquences plus lourdes selon l’environnement dans lequel il s’inscrit.
On l’a dit, quel que soit leur lieu de vie, les femmes assument l’essentiel des tâches familiales et domestiques. Mais, en ruralité, cette charge prend une épaisseur supplémentaire parce qu’elle se déploie dans un milieu où chaque nécessité du quotidien – se rendre à l’école, accompagner aux activités, effectuer une démarche administrative, travailler, consulter un médecin… – suppose un déplacement souvent long, rarement mutualisable et bien souvent à leur charge. Ici, la division genrée du travail rencontre ce que Jacques Lévy nomme la justice spatiale14Voir Jacques Lévy, Théorie de la justice spatiale, géographies du juste et de l’injuste, Paris, Odile Jacob, 2018. : le simple fait d’habiter loin des services multiplie le coût temporel et organisationnel de chaque obligation.
Certains travaux récents ont montré que près de 86,5 % des femmes rurales géraient les démarches administratives du foyer, que 70 % accompagnaient les enfants à l’école que 74,2 % les accompagnaient pour leurs activités extrascolaires15Émilie Agnoux et Émilie Nicot, Accéder aux services publics en milieu rural : les femmes en première ligne ?, Fondation Jean-Jaurès, juin 2023, p. 3.. Autant de responsabilités qui, en ville, peuvent être partagées ou allégées par les infrastructures de transport et la densité des services mais qui, en ruralité, deviennent des heures de route cumulées, des semaines fragmentées, une énergie morcelée.
Cette géographie peu dense, où chaque activité implique un déplacement, alourdit la dimension logistique des responsabilités domestiques. Ainsi, si le partage des tâches domestiques est peu ou prou équivalent dans les couples urbains et ruraux, la charge mentale qui pèse sur les femmes rurales est augmentée par la distance et la logistique afférente. Lorsque l’on demande aux femmes rurales quelle est la personne qui porte, dans leur foyer, la charge mentale de la famille, elles sont donc 40 % à dire que c’est presque exclusivement elle. Cette proportion est de 33 % chez les femmes urbaines, soit 7 points d’écart.
b/ Le coût temporel de la ruralité
La logique du don coûte plus cher en ruralité. Non parce qu’elle est essentiellement féminine, mais parce qu’elle s’exerce dans un territoire qui amplifie mécaniquement la charge invisible : plus de kilomètres, moins d’alternatives, davantage d’imprévus, plus de dépendance à la voiture, plus de temps soustrait à soi.
À titre d’exemple, lorsque l’on interroge femmes et hommes sur leur temps réellement disponible pour eux-mêmes, sans obligation familiale ni professionnelle, la ruralité amplifie les écarts de genre. Ainsi, 19 % des femmes rurales déclarent disposer de moins de deux heures par semaine pour elles-mêmes, soit une différence de 12 points avec les hommes ruraux (7 %). En milieu urbain, le delta s’avère deux fois moins élevé, limité à 6 points (15 % pour les urbaines contre 9 % pour les urbains). Le genre crée l’écart et la ruralité l’amplifie. Le delta en ruralité est même encore plus frappant lorsque l’on sonde des seuils plus élevés : 47 % des femmes rurales disposent de moins de cinq heures hebdomadaires, contre 25 % des hommes ruraux, soit un écart de 22 points. C’est plus du double du delta urbain, limité à 10 points entre les urbaines (41 %) et les urbains (31 %).
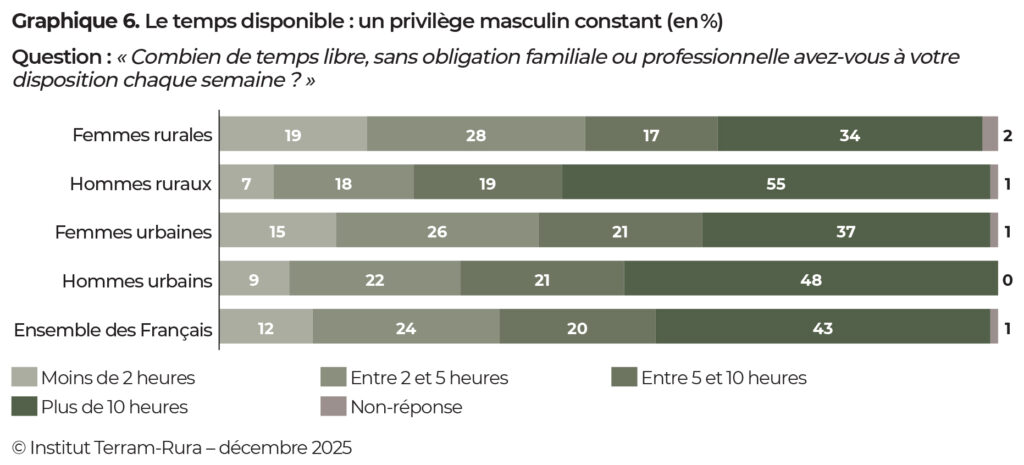
L’arrivée d’enfants amplifie encore ces déséquilibres. Ainsi, 58 % des femmes rurales célibataires avec enfant estiment disposer de moins de cinq heures de temps pour elles par semaine, contre 39 % des hommes ruraux célibataires avec enfant. Le mariage creuse davantage l’écart : 57 % des femmes rurales mariées avec enfant déclarent avoir moins de cinq heures pour elles. C’est 25 points de plus que les hommes ruraux mariés avec enfant (32 %).
Ce phénomène met en évidence ce que l’on peut nommer un « malus rural du genre » : les inégalités domestiques ne changent pas de nature à la campagne, mais elles s’intensifient sous l’effet des contraintes territoriales. Les travaux sur l’économie du temps montrent que la charge domestique ne dépend pas seulement du nombre de tâches, mais du coût temporel de leur réalisation. Or, en zones peu denses, ce coût est objectivement plus élevé : davantage de trajets, d’éloignement, d’imprévus logistiques, moins de services accessibles, une moindre externalisation possible du travail domestique.
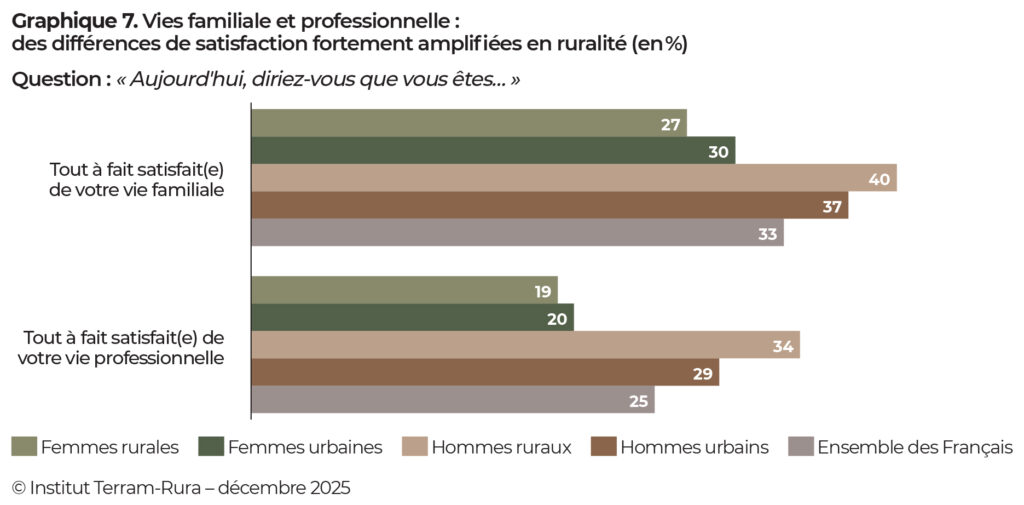

c/ Travail, responsabilités familiales et satisfaction : un écart accru en zones peu denses
Les niveaux de satisfaction exprimés à la fois pour la vie familiale et la vie professionnelle révèlent des écarts de genre nettement plus prononcés en ruralité qu’en milieu urbain. Alors que les femmes sont partout moins satisfaites que les hommes, cet écart se creuse particulièrement dans les espaces peu denses, où les contraintes du quotidien et la charge mentale accrue réduisent davantage les marges du bien-être féminin.
Ces écarts se retrouvent dans la place accordée à la parole au travail. Un quart des actives, rurales comme urbaines, déclarent ainsi être souvent peu écoutées dans leur environnement professionnel. Mais, en ruralité, le delta entre femmes et hommes atteint 8 points (24 % contre 16 %), alors qu’il n’est que de 5 points en milieu urbain (26 % contre 21 %).
Ces logiques se prolongent dans la sphère domestique. Si une majorité de femmes, en ville comme à la campagne, estiment que les responsabilités familiales limitent leurs marges de manoeuvre, les écarts de genre sont, là encore, plus prononcés en ruralité. À la question : « Vos responsabilités au sein du foyer limitent-elles vos possibilités professionnelles ou personnelles ? », le delta est de 16 points entre femmes et hommes urbains (39 % contre 23 %), mais grimpe jusqu’à 22 points en ruralité (38 % contre 17 %). Loin d’être un simple décor, le territoire agit comme un multiplicateur des rapports sociaux, transformant des écarts déjà structurels en asymétries plus profondes. Ce « malus rural du genre » met en lumière l’articulation étroite entre division genrée du travail, organisation spatiale et disponibilité des ressources collectives. Là où les infrastructures, les services et les mobilités sont plus rares, la charge invisible se densifie mécaniquement et pèse davantage sur les femmes. Il en résulte une économie du temps plus contrainte, une autonomie plus restreinte et des marges de choix plus étroites, tant dans la sphère intime que professionnelle. Ce faisceau de contraintes rappelle, en creux, que les politiques d’égalité femmes-hommes ne peuvent être pensées indépendamment des politiques territoriales : s’attaquer aux inégalités de genre suppose aussi de corriger les inégalités d’accès, de distances et de services, qui les intensifient.
II. La fabrique des trajectoires féminines rurales
1. Celles qui partent, celles qui restent
a/ La fin du collège : premier éloignement, premier tri des possibles
De nombreux facteurs conditionnent les choix, les attentes et les perspectives des jeunes ruraux. Trois dimensions en particulier jouent un rôle décisif : le poids du genre, celui du milieu social et celui du territoire. Chacune de ces dimensions exerce une influence propre, mais c’est leur combinaison qui détermine le plus fortement les possibles. Ainsi, quand on est une jeune fille dans un village des Pyrénées, des Vosges ou du Loiret, la faible densité du territoire, les distances à parcourir chaque jour et la rareté des infrastructures modèlent le quotidien, orientent les aspirations et dessinent le futur.
C’est désormais un fait reconnu et de plus en plus documenté : les jeunes ruraux sont confrontés à la nécessité d’ajuster leurs ambitions scolaires à la géographie de l’offre disponible. De 3 à 14 ans, leurs domiciles sont en moyenne éloignés de leurs écoles et collèges par 10,5 kilomètres. À l’entrée au lycée, la distance fait plus que doubler et atteint 23,2 kilomètres pour les 15-17 ans16Benjamin Méreau et Sonia Oujia, « Grandir en milieu rural : des trajets plus longs pour aller à l’école », Insee Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur, n° 77, 18 janvier 2022, p. 2.. Un éloignement d’autant plus déterminant que les réseaux de transports en commun desservent mal 53 % des jeunes ruraux pour le bus et 62 % pour le train17Félix Assouly, Salomé Berlioux et Victor Delage, Jeunesse et mobilité : la fracture rurale, Institut Terram-Rura, mai 2024, p. 21..
Sans surprise, le défi de l’orientation s’impose de façon particulière aux jeunes filles rurales et notamment à celles de milieux populaires, majoritaires en ruralité. L’effet de genre qui s’impose à ces « filles du coin18Voir Yaëlle Amsellem-Mainguy, Les Filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural, Paris, Presses de Sciences Po, 2021. » s’appuie en effet sur un attendu genré qui ne s’applique pas autant aux garçons. Parce qu’elles contribuent souvent, dès l’enfance, aux tâches domestiques et familiales (ménage, courses, garde des plus petits, aide aux aînés…), ces jeunes filles sont perçues comme nécessaires à l’équilibre du foyer, ce qui rend leur départ moins évident, moins encouragé, parfois moins légitime à leurs propres yeux. Elles‑mêmes le perçoivent bien et en témoignent, racontant que leurs grands frères ont été soutenus, voire incités à partir à l’internat, quand elles-mêmes se sont senties retenues.
À ces réticences à voir les jeunes filles rurales de milieu populaire quitter leur famille à 15 ans s’ajoute un autre phénomène : la forte proportion d’entre elles qui souhaitent s’orienter vers des métiers du care. Ces filières professionnalisantes sont en effet davantage présentes et mieux réparties dans les zones peu denses et très peu denses. Elles constituent des trajectoires de proximité particulièrement investies par les jeunes filles rurales, pour qui s’éloigner représente un coût financier, logistique et affectif. En adéquation, en outre, avec un réflexe féminin qui, lui, n’est pas territorialisé : celui de vouloir prendre soin des autres et d’injecter très tôt cette donne dans sa trajectoire professionnelle.
b/ La majorité : bascule décisive et exode sélectif des filles rurales
Si la dialectique entre partir et rester structure les trajectoires des jeunes ruraux dès l’âge de 15 ans, elle atteint son paroxysme à 18 ans, au moment du baccalauréat et de la potentielle entrée dans l’enseignement supérieur. À cet âge charnière, les jeunes ruraux doivent décider non seulement de ce qu’ils feront à la rentrée de septembre, mais aussi de ce que ce choix impliquera, pour eux, en termes de lieu de vie.
La géographie de l’enseignement supérieur rend ce choix lourd de conséquence, avec 83 % des places proposées sur Parcoursup situées dans les grandes agglomérations19« 48 % des places proposées sur Parcoursup sont situées dans les grandes agglomérations à forte concentration de fonctions métropolitaines, 35 % dans les autres grandes agglomérations dotées de gros employeurs et 8 % dans les zones à économie diversifiée ; enfin les zones résidentielles, touristiques, spécialisées dans l’agriculture ou dans l’industrie, en regroupent seulement 9 % » (Olivier Pucher, Émeline Avila et Willy Thao Khamsing, « En 2022, 58 % des nouveaux bacheliers quittent leur zone d’emploi en entrant dans l’enseignement supérieur », Insee Première, n° 2031, 8 janvier 2025, p. 1).. L’écrasante majorité de l’offre post-bac contraint donc les jeunes ruraux à envisager le départ. La poursuite d’études n’est alors pas seulement un projet scolaire, mais aussi un projet de mobilité. L’effet démographique s’avère d’ailleurs immédiat. À 17 ans, un tiers des jeunes Français sont ruraux (33 %) ; un an plus tard, ils ne sont plus qu’un quart (24 %). En quelques mois, un cinquième des jeunes ruraux quittent leur territoire. Avoir 18 ans coïncide donc pour beaucoup avec un premier exode urbain.
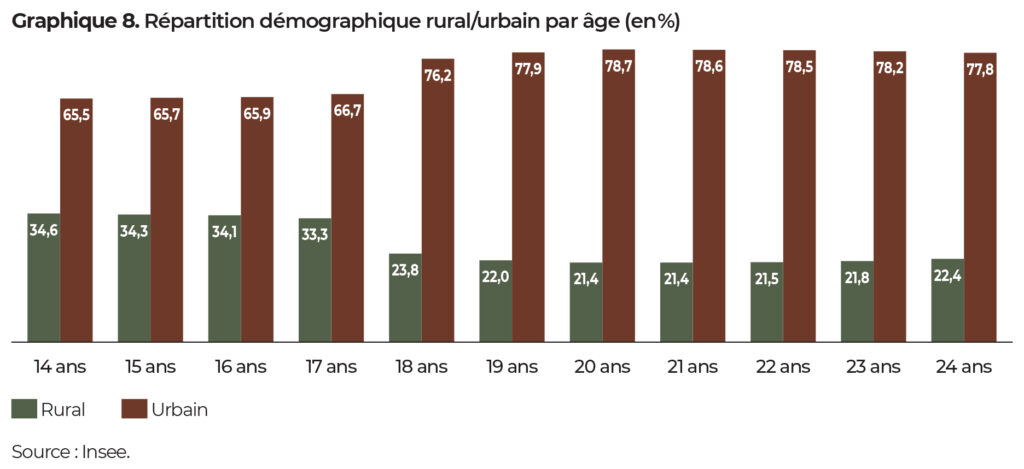
En proportion, le départ à 18 ans concerne plus les filles rurales que leurs homologues masculins, qui, eux, suivent en moyenne des parcours scolaires plus courts et moins généraux20« En moyenne, les filles s’orientent beaucoup plus souvent que les garçons vers la voie générale (68 % contre 57 %), mais l’écart filles-garçons est d’autant plus élevé que le territoire est de type rural. Il s’élève à 17 points dans le rural (63 % contre 46 %) et à 9 points dans l’urbain (69 % contre 60 %) » (Claudine Pirus, « Le parcours et les aspirations des élèves selon les territoires. Des choix différenciés en milieu rural ? », Éducation & Formations, n° 102, juin 2021, p. 342). Voir aussi Jean-Jacques Arrighi, « Les jeunes dans l’espace rural : une entrée précoce sur le marché du travail ou une migration probable », Formation Emploi, n° 87, juillet-septembre 2004. p. 63-78 ; Sophie Orange et Fanny Renard, avec la collaboration de Sofia Aouni, « Au bonheur des dames. Attachement local et relations d’obligations dans l’accès à l’âge adulte des jeunes femmes d’origine populaire et rurale », rapport final de la post-enquête Rurelles pour la DREES-Ministère des solidarités, CENS/Université de Nantes-Gesco/Université de Poitiers, novembre, 2018.. Le départ s’explique alors par un double mouvement.
D’une part, les emplois peu qualifiés disponibles en territoires ruraux sont en grande partie associés à des métiers socialement construits comme masculins (bâtiment, transport, logistique, agriculture…)21Voir Laurie Pinel, « Conditions de vie des jeunes femmes en zone rurale : des inégalités par rapport aux hommes ruraux et aux urbaines », Études & Résultats, n° 1154, juillet 2020.. Les jeunes filles qui aspirent à une autre voie doivent s’orienter vers des études supérieures qualifiantes. Et donc s’éloigner de chez elles.
D’autre part, les filles rurales sont plus souvent perçues comme « scolaires » que leurs homologues masculins. Elles obtiennent d’ailleurs en moyenne de meilleurs résultats au baccalauréat que les garçons du même territoire22« Trois femmes sur dix dont les parents vivent dans des territoires ruraux résident dans des zones urbaines, contre deux hommes sur dix » (Laurie Pinel, op. cit., p. 1).. Le choix de faire des études se confond alors avec celui de partir. La majorité devient un moment d’ouverture, mais aussi d’arrachement.
Dans le prolongement des premiers choix d’orientation post-brevet, les jeunes filles qui demeurent dans leur commune ou ses environs après leur majorité sont généralement celles issues de milieux plus modestes. Les données sur la mobilité étudiante le confirment : « Plus l’origine sociale d’un candidat est favorisée au regard des chances de réussite scolaire, plus celui-ci exprime une forte demande de mobilité : c’est le cas de 65 % des demandes des néo-bacheliers d’origine sociale très favorisée ou favorisée, 62 % de ceux moyennement favorisés et 56 % des défavorisés23Olivier Pucher, Émeline Avila et Willy Thao Khamsing, art.cit., p. 2.. »
Au-delà de la capacité qu’ont les jeunes rurales de milieu plus favorisé de se projeter vers des études qui impliquent d’aller en ville, celles issues des milieux populaires se heurtent de nouveau à une contrainte majeure : la difficulté financière de quitter le domicile familial pour poursuivre leur formation. Là où la décohabitation constitue un horizon envisageable pour certaines, elle représente, pour d’autres, un obstacle infranchissable. Dans ces conditions, les études courtes et de proximité acquièrent de nouveau une valeur particulière : elles permettent de rester au sein du réseau familial, de limiter les coûts et d’ajuster son parcours d’orientation à l’offre disponible dans un rayon raisonnable autour du domicile. À moyen terme, ce choix assure une insertion plus rapide sur le marché du travail en local. L’ambition scolaire des jeunes femmes s’accorde non pas au désir, mais au possible.

2. Rester et correspondre aux attendus : le poids local des normes de genre
a/ Des attendus différenciés entre hommes et femmes : la respectabilité au féminin
Les jeunes femmes qui restent au sein de leur territoire rural ou qui y reviennent après une mobilité étudiante, ont, pour beaucoup, l’ambition de s’y installer durablement. Cette projection s’accompagne d’un minutieux travail d’inscription locale. Elles cherchent alors à consolider leur place dans les réseaux de sociabilité du territoire, socle de reconnaissance mutuelle, de solidarités implicites et d’avantages concrets dans la vie quotidienne.
Dans cette perspective, les jeunes rurales doivent développer leur capital d’autochtonie, c’est-à-dire « l’ensemble des ressources que procure l’appartenance à des réseaux de relations localisés24Nicolas Renahy, « Classes populaires et capital d’autochtonie. Genèse et usages d’une notion », Regards sociologiques, n° 40, 2010, p. 9. », ressources « dont ne peuvent se dispenser les classes populaires pour participer à la vie sociale25Jean-Noël Retière, « Autour de l’autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire », Politix, n° 63, 2003. ». L’autochtonie agit à la fois comme un actif à investir et comme une norme à satisfaire. C’est un capital qui se gagne autant qu’il doit être nourri. Autrement dit, il ne suffit pas d’être là. Il faut montrer que l’on appartient, signifier sa familiarité avec le territoire, manifester sa conformité aux attentes locales. Cette exigence est d’autant plus forte pour les jeunes femmes résidant dans des villages ou des bourgs où elles ne sont pas nées26Voir Benoît Coquard, Ceux qui restent, faire sa vie dans les campagnes en déclin, Paris, La Découverte, 2022.. Ne pouvant pas toujours s’appuyer sur un ancrage familial ancien ni sur une jeunesse passée sur place, les rurales doivent alors produire les signes d’une appartenance dont elles n’ont pas hérité.
Dans ce processus, la conformité aux normes de genre occupe une place centrale. Correspondre à ce que l’on attend d’une « jeune fille du coin » devient un enjeu stratégique. Toute singularité trop marquée risque de fragiliser le capital d’autochtonie en donnant l’impression d’un décalage, d’une inadéquation avec l’identité du lieu. Les normes de genre sont ici particulièrement puissantes. Elles sont autant définies et alimentées par des déterminations lointaines (médias, réseaux sociaux, contenus culturels, marketing et objets de consommation…) que par des prescriptions proches (amis, famille, professeurs, milieux professionnels…). Ainsi, dans un contexte rural où l’interconnaissance et la reconnaissance locales sont cruciales, les femmes qui se conforment aux normes genrées valorisées peuvent consolider leur inscription dans les réseaux d’appartenance et transformer ce positionnement conforme en ressource sociale.
Cette adéquation aux attentes locales ne relève pas seulement de comportements visibles. Elle s’inscrit également dans des dispositions intériorisées, façonnées par le regard des autres, mais aussi par le regard que les femmes portent sur elles-mêmes. Les normes de genre sont d’autant plus puissantes qu’elles sont cognitives avant d’être prescriptives. Elles s’invitent dans ce que les femmes croient devoir être, à chaque âge de leur vie.
Notre enquête met en évidence cette intériorisation. À la question : « Dans votre environnement familial et amical, qu’est-ce qui vous semble particulièrement attendu des femmes ? », les rurales identifient parmi les attentes prioritaires trois injonctions très éloignées de celles que les hommes ruraux projettent sur eux‑mêmes. Les réponses les plus fréquentes, en moyenne, sont de manière constante :
- « qu’elles s’occupent bien de leur foyer » (57 % des femmes rurales, contre 40 % des hommes) ;
- « qu’elles soient disponibles pour les autres » (36 % contre 24 %) ;
- « qu’elles aient des enfants » (38 % contre 17 %).
Ces chiffres ne traduisent pas seulement une différence de perception. Ils montrent un continuum normatif qui encadre la vie des femmes rurales. Chaque période de la vie accentue des attentes spécifiques. Ainsi les femmes rurales, entre 35 et 49 ans, sont-elles 48 % à considérer qu’avoir des enfants est un attendu prioritaire, plaçant cette injonction en deuxième position, juste derrière celle de « bien s’occuper de leur foyer » (67 %). Ce pic révèle une phase de la vie où les normes de genre se resserrent autour de la maternité et de la domesticité. Comme si l’accomplissement féminin devait alors s’inscrire dans un double registre : la responsabilité familiale et la disponibilité.
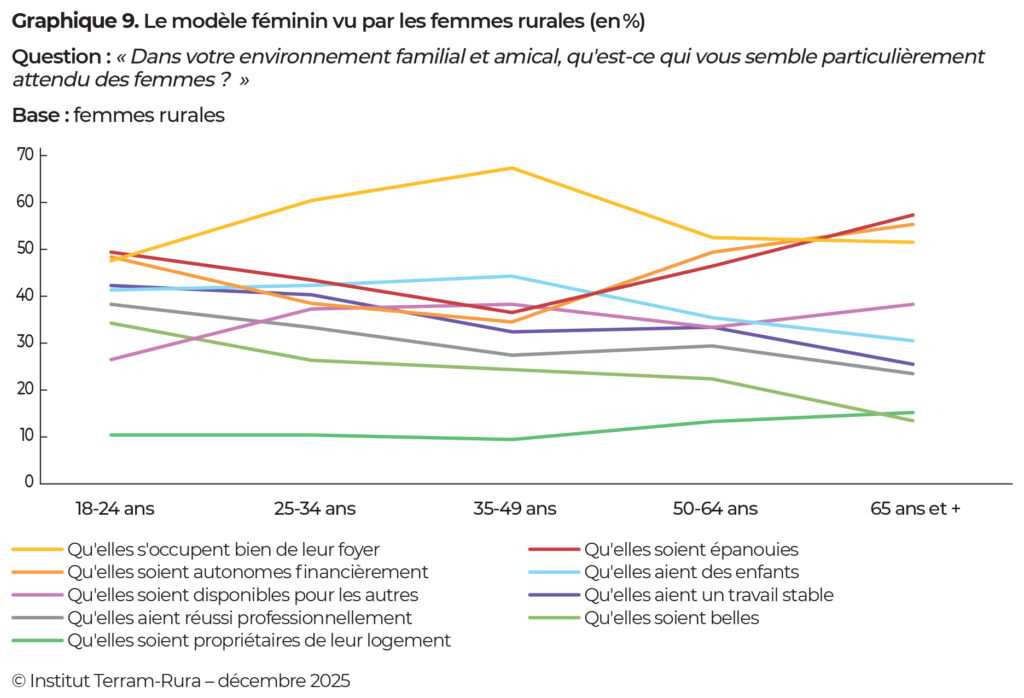
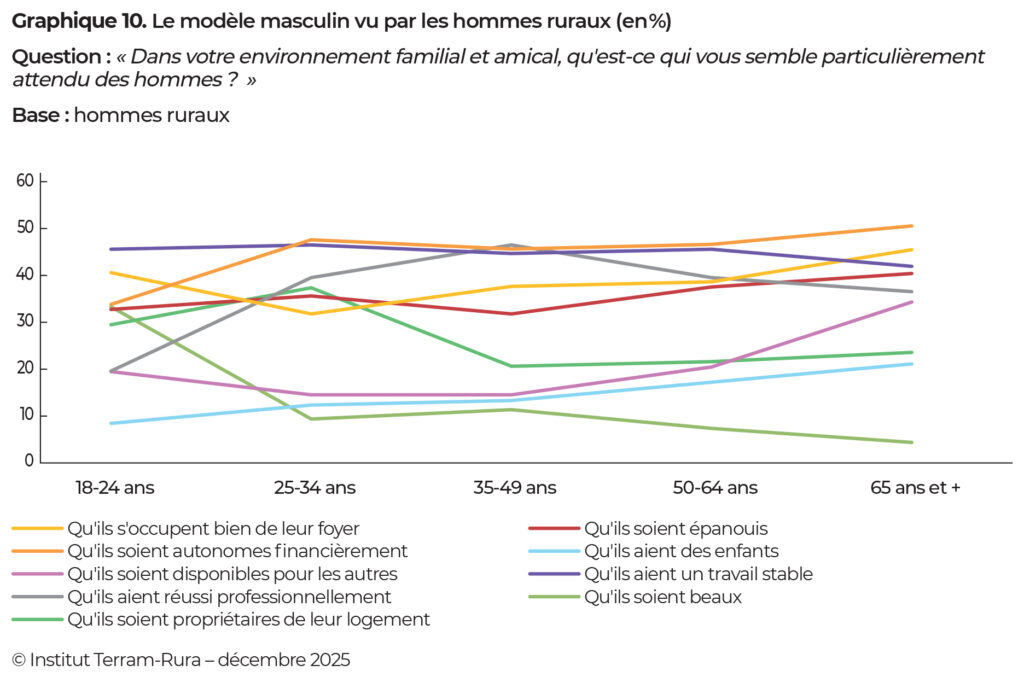
Certaines attentes sont, en moyenne, un peu plus partagées avec les hommes ruraux, notamment l’épanouissement (45 % des femmes rurales, 36 % des hommes) ou l’autonomie financière (44 % contre 47 %). Toutefois, les dynamiques au fil des âges divergent fortement selon le genre. Chez les femmes, ces attentes valorisant l’autonomie et l’accomplissement individuel semblent s’affaiblir quand les injonctions liées au foyer deviennent prédominantes, c’est-à-dire entre 25 et 50 ans. Cette période correspond précisément à celle où les normes d’investissement domestique et familial atteignent leur maximum. Pour les femmes rurales, l’autonomie financière ou l’épanouissement personnel deviennent alors des objectifs secondaires, relégués derrière les attentes sociales de maternité, de disponibilité et de bonne gestion du foyer.
Les hommes ruraux, eux, font face à un tout autre régime d’attentes. Les normes qui pèsent sur eux restent centrées sur la réussite professionnelle (38 % des hommes ruraux, contre 28 % des femmes rurales), la stabilité de leur emploi (43 % contre 32 %) et l’autonomie financière. Le fait de « bien s’occuper du foyer » apparaît dans leurs réponses, mais revêt un sens distinct : il ne s’agit pas d’une responsabilité quotidienne, mais plutôt d’une contribution morale ou symbolique.
Ce décalage ressort nettement lorsque, dans une autre question, plus de cinq hommes ruraux sur dix (54 %) déclarent que l’on attend d’eux qu’ils « subviennent aux besoins financiers du foyer », proportion encore plus forte chez les plus jeunes (60 % des moins de 25 ans) et chez les plus âgés (64 % des plus de 65 ans). Sans surprise, le pourvoi aux ressources du foyer apparaît comme une obligation masculine, la gestion matérielle et émotionnelle du foyer comme une obligation féminine.
Tout se passe alors comme si les femmes rurales étaient placées à la croisée de deux systèmes d’attentes : l’un, local, qui valorise leur inscription dans les réseaux de proximité ; l’autre, genré, qui prescrit la disponibilité, le soin et la continuité domestique. Ces attentes se renforcent mutuellement. Parce que la conformité aux normes locales est indispensable pour stabiliser son capital d’autochtonie et parce que ces normes locales sont elles-mêmes traversées par des injonctions de genre, les femmes rurales se retrouvent encouragées à privilégier certaines orientations, considérées comme féminines et socialement valorisées. Ainsi, en zones rurales, les attendus genrés ne se contentent-ils pas d’influencer les aspirations. Ils conditionnent les trajectoires personnelles et professionnelles, en orientant les femmes vers des voies perçues comme légitimes, acceptables ou socialement rassurantes, parfois au détriment de leurs ambitions propres. Le territoire, en tant que structure de normes et d’opportunités, participe à définir les contours, les logiques d’expression et les formes d’acceptabilité sociale qui pèsent sur les femmes.
b/ Se mettre en couple : un amortisseur économique à sens unique
En comparaison avec les urbaines, les rurales se mettent en couple plus tôt et en proportion plus élevée. Cette entrée plus précoce dans la conjugalité ne relève pas seulement de trajectoires individuelles ou affectives. Elle s’inscrit dans l’ensemble d’attendus de genre décrits précédemment, où la stabilité conjugale et la création d’un foyer constituent des marqueurs forts d’intégration sociale. Au-delà de l’intention personnelle et des sentiments amoureux qui motivent la mise en couple, cette étape est aussi une norme de vie adulte, porteuse de reconnaissance locale et de respectabilité.
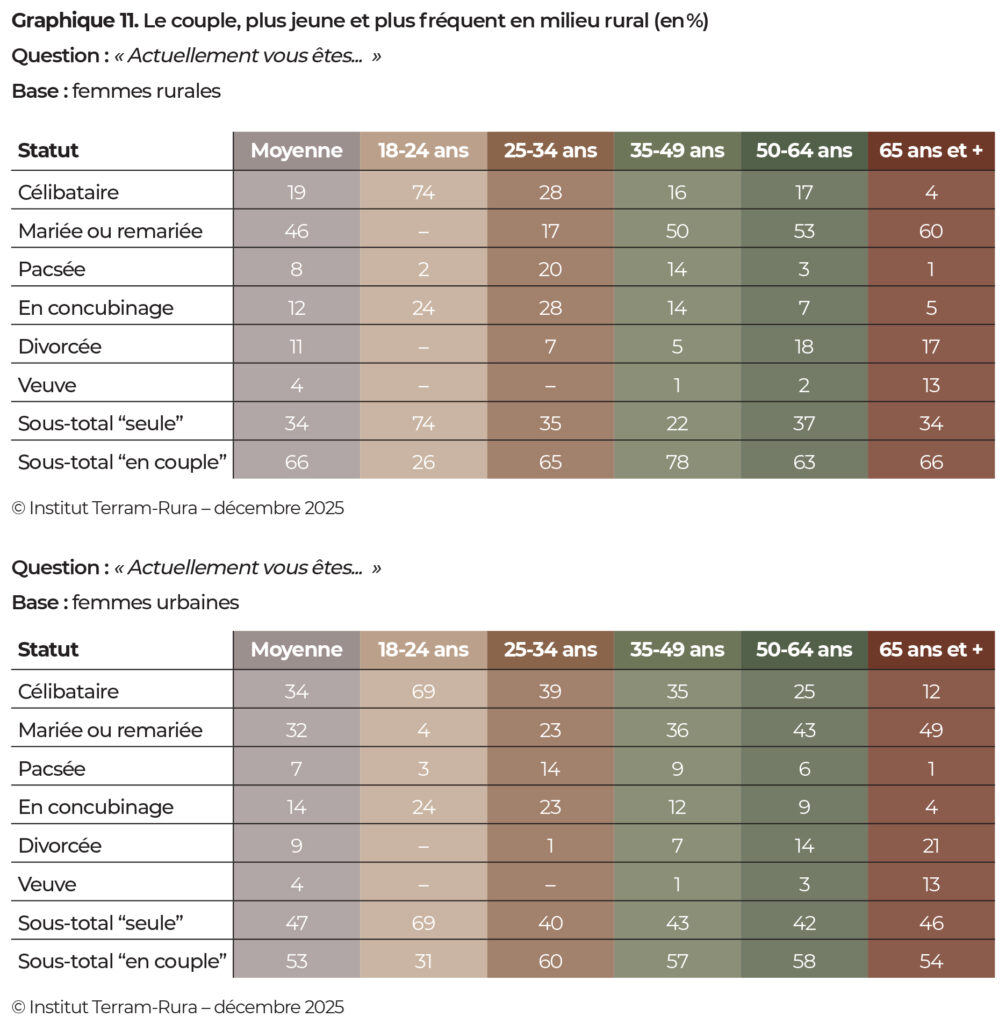
Mais ce phénomène a également une dimension économique. Les femmes rurales disposent en moyenne de revenus inférieurs à ceux des hommes ruraux. Dans ce contexte, la mise en couple joue un rôle d’amortisseur financier. Le partage des dépenses du quotidien (logement, énergie, courses, déplacements…) constitue un avantage objectif. Cette mutualisation des ressources se traduit immédiatement dans les données : pour les dépenses alimentaires, les difficultés financières déclarées diminuent de 13 points entre les femmes rurales célibataires sans enfant (50 %) et les femmes rurales en couple sans enfant (37 %).
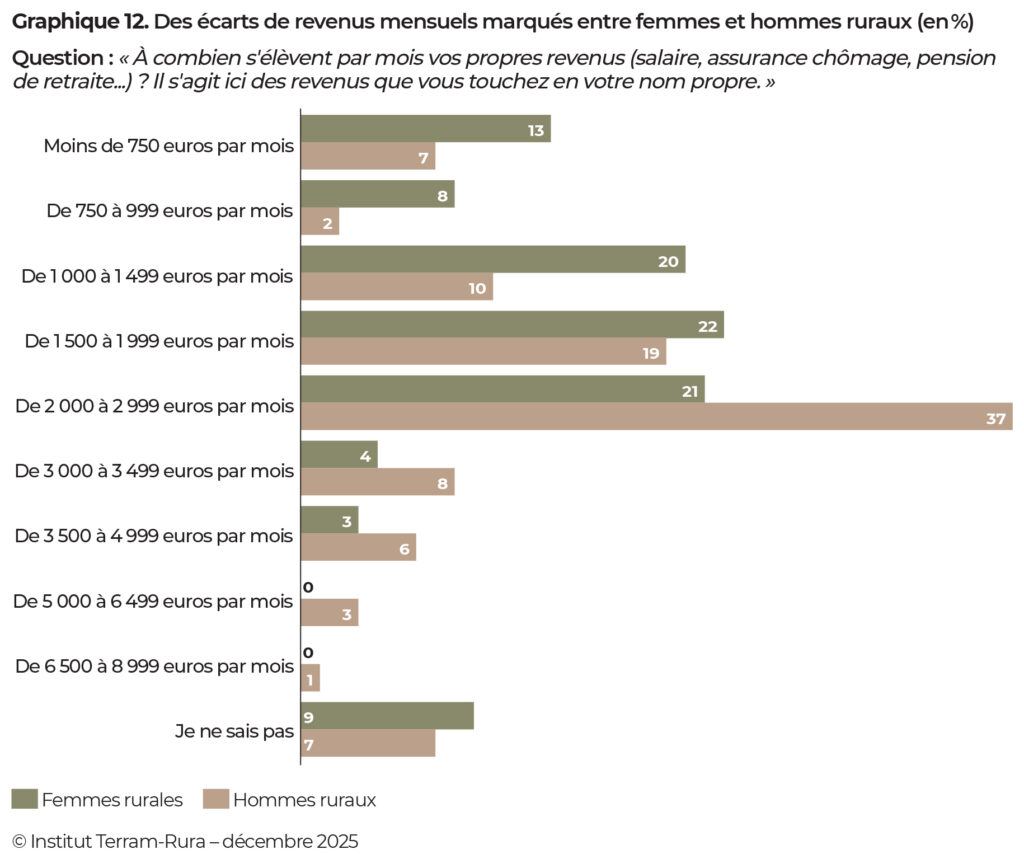
Cette dynamique s’observe de façon analogue sur 15 des 18 postes de dépenses analysés, dont 11 affichent une amélioration supérieure ou égale à 5 points. Le gain économique est donc largement transversal.
Les hommes ruraux célibataires sans enfant bénéficient eux aussi d’un intérêt économique à la conjugalité. Mais cet effet est nettement moins marqué : seuls 5 postes sur 18 présentent une amélioration d’au moins 5 points.
L’effet multiplicateur de la conjugalité devient encore plus visible lorsque le couple a des enfants. Pour les femmes, l’amélioration du pouvoir d’achat dépasse 10 points sur 14 des 18 postes de dépenses analysés. Pour les hommes, c’est le cas pour 13 postes. Pour les dépenses alimentaires par exemple, le pouvoir d’achat des femmes avec enfant s’améliore de 25 points lorsqu’elles sont en couple, contre seulement 5 points pour les hommes.
Ce constat en suggère un autre, tout aussi crucial. Si la mise en couple améliore le niveau de vie des femmes rurales, la séparation produit l’effet inverse, avec une intensité disproportionnée. S’extraire constitue pour une femme rurale une chute économique plus brutale que pour un homme, en raison de revenus individuels plus faibles, d’opportunités professionnelles plus limitées, de réseaux de sociabilité locaux souvent plus limités et d’une plus grande charge financière du quotidien lorsqu’elle vit seule.
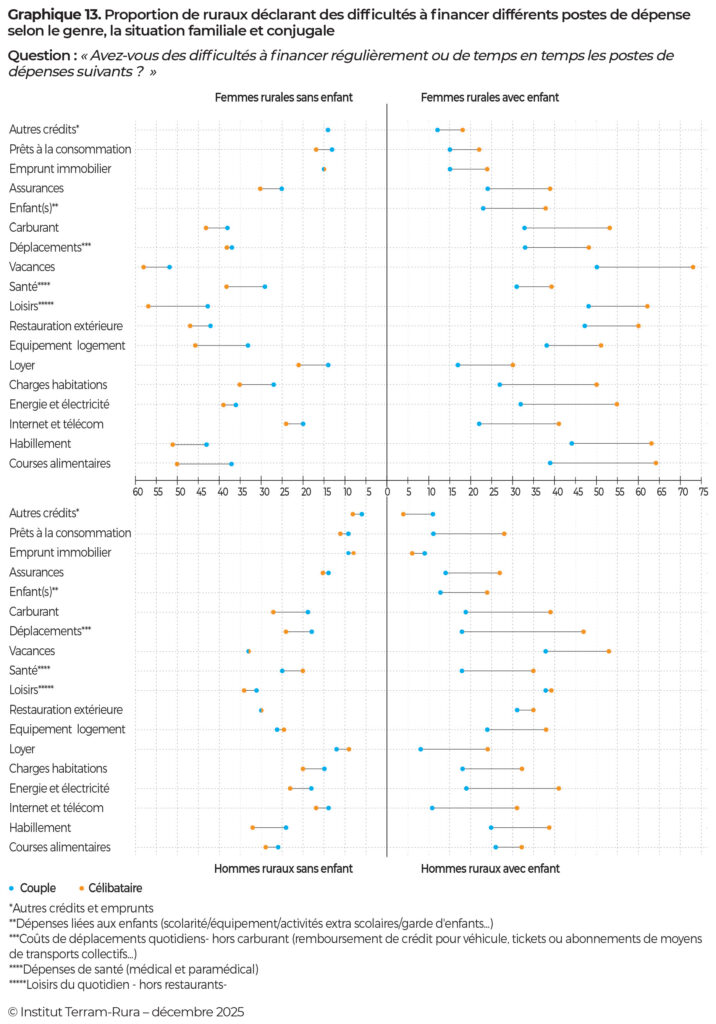
c/ Devenir parent : la tension entre mode de garde et activité professionnelle des femmes
Toutes générations confondues, les femmes rurales ont plus souvent des enfants que les femmes urbaines. Près des deux tiers (64 %) d’entre elles sont mères, contre 49 % en ville. Dans un modèle où la répartition des tâches familiales demeure fortement genrée, l’arrivée d’un enfant produit des effets profonds sur l’organisation du couple. Ces effets pèsent plus lourdement sur les femmes rurales que sur leurs homologues urbaines.
Une fois les congés maternité et paternité écoulés, les enfants doivent être gardés pour permettre la reprise d’activité des parents. Or, sur ce point, les territoires ruraux présentent des contraintes structurelles fortes : l’offre de garde collective y est plus rare, plus éloignée, moins adaptée aux horaires réels du travail rural. En moyenne, les familles rurales disposent de 8 places en crèche à moins de 15 minutes pour 100 enfants de moins de 3 ans, contre 26 en milieu urbain27Pauline Virot, « Grandir dans un territoire rural : quelles différences de conditions de vie par rapport aux espaces urbains ? », Études & Résultats, n° 1189, mars 2021, p. 5.. Cette asymétrie transforme la garde d’enfants en un problème logistique quotidien.
Face à cette pénurie, les assistantes maternelles constituent le mode de garde payant le plus utilisé en ruralité : 87 % des familles rurales y ont recours (contre 63 % au national)28Danielle Even et Bertrand Coly, « Place des jeunes dans les territoires ruraux », Conseil économique et social, janvier 2017, p. 17. et ce malgré un reste à charge plus élevé (1,40 euro de l’heure contre 1,20 euro en crèche)29Pauline Virot, art. cit., p. 5.. Le système d’accueil ne répond pas toujours aux contraintes horaires des familles rurales, dont les journées de travail, transports compris, sont longues. Ainsi les parents ruraux ont-ils davantage recours à des gardes avant 8 heures, après 19 heures ou le week-end (24 % contre 16 % en urbain)30Ibid.. L’amplitude horaire, combinée à la rareté de l’offre, renchérit mécaniquement le coût de la garde.
Dans nombre de foyers, la question se pose donc en termes strictement économiques : entre payer une garde coûteuse et ajouter à ces coûts les frais liés à la mobilité pendulaire, il est parfois plus rationnel qu’un des deux parents cesse temporairement son activité. Les arbitrages financiers rendent alors la question du retrait professionnel plus économique qu’idéologique. Compte tenu des niveaux de revenus différenciés au sein des couples, ce sont très majoritairement les femmes qui suspendent ou abandonnent leur emploi. Dans les couples où les deux membres travaillent à temps plein (44 % des couples), les femmes contribuent à 44 % des revenus du foyer. En revanche, dans les couples où l’homme est à temps plein et la femme à temps partiel (21 % des couples), la contribution féminine tombe à 34 %, contre 66 % pour les hommes31Voir Thomas Morin, « Écarts de revenus au sein des couples. Trois femmes sur quatre gagnent moins que leur conjoint », Insee Première, n° 1492, mars 2014, p. 1.. Avec des niveaux de revenus en moyenne plus bas que ceux de leurs conjoints, il devient plus rationnel, au sens économique du terme, que ce soit la femme qui diminue ou cesse son activité. Cette logique est forte en ruralité, où les écarts de salaires entre femmes et hommes sont plus importants.
Illustrant cette dynamique, la proportion de femmes rurales se déclarant « femme au foyer » augmente précisément dans les tranches d’âge où elles ont le plus d’enfants : 15 % entre 25 et 34 ans, 19 % entre 35 et 49 ans. Cette proportion varie fortement en fonction de la composition familiale : seules 9 % des femmes sans enfant de moins de 18 ans se déclarent au foyer, contre 23 % parmi celles qui en ont trois ou plus.
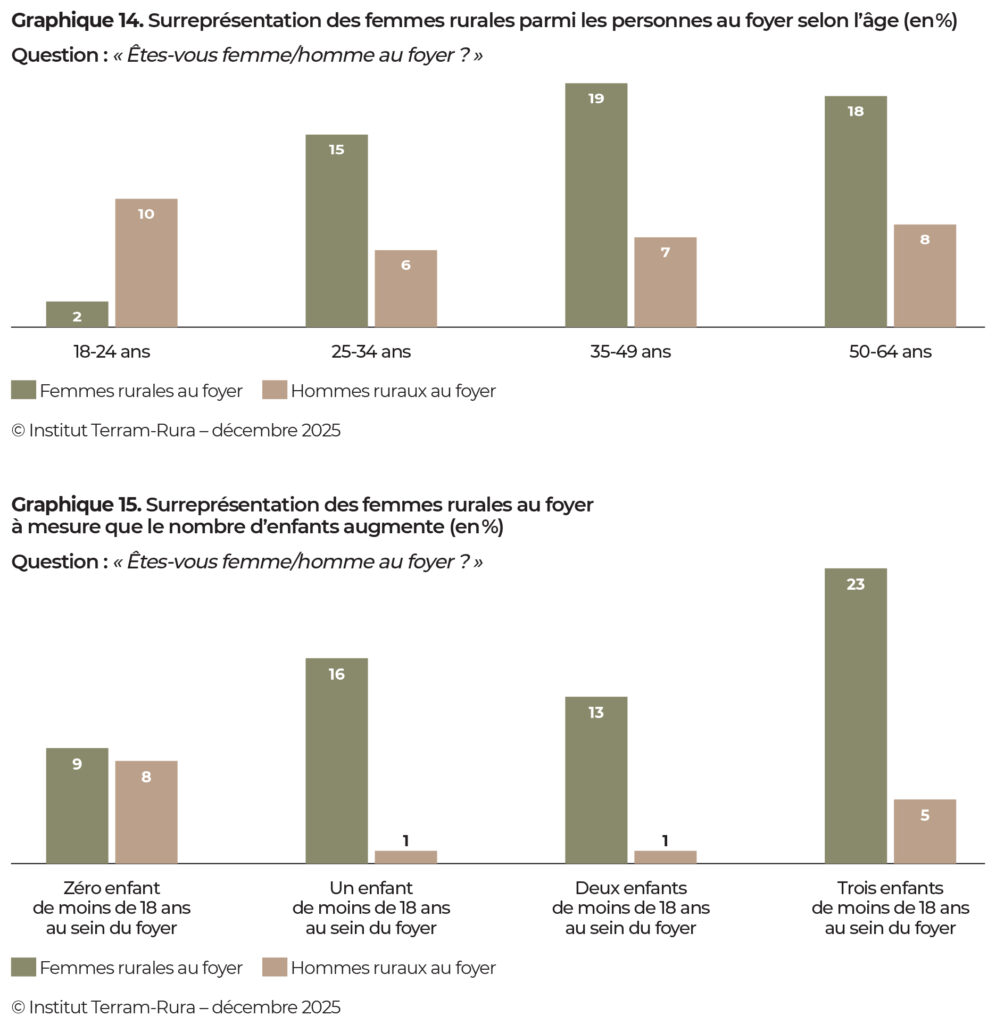
Chez les hommes ruraux, la logique est radicalement différente. La proportion d’hommes au foyer ne varie ni selon l’âge, ni selon le nombre d’enfants. Ils sont même plus nombreux à se déclarer au foyer lorsqu’ils n’ont aucun enfant de moins de 18 ans (8 %) que lorsqu’ils en ont trois ou plus (5 %). Le rôle de parent n’entraîne donc pas, pour les hommes ruraux, de retrait du marché du travail. Là où l’arrivée d’enfants modifie profondément la trajectoire professionnelle des femmes, elle ne modifie quasiment pas celle des hommes.
Cette évolution résulte de deux dynamiques intimement liées. La première tient aux attendus de genre, qui prescrivent aux femmes un rôle central dans la sphère familiale et domestique. La seconde relève d’un calcul économique rationnel à l’échelle du foyer.
3. Les femmes rurales face à l’insécurité financière
a/ Un sentiment d’autonomie financière en trompe-l’oeil
Lorsque l’on interroge les femmes rurales sur leur sentiment d’indépendance financière, les réponses varient fortement selon la situation familiale. Tant qu’elles vivent seules, célibataires et sans enfant, l’immense majorité (86 %) d’entre elles se déclarent financièrement indépendantes. Cette autonomie ressentie se dégrade pourtant dès l’entrée dans la conjugalité. En couple, sans enfant, elles ne sont plus que 72 % à se sentir indépendantes et 76 % lorsqu’elles sont en couple avec enfant.
Chez les hommes ruraux, la dynamique est inverse. Alors que les femmes perdent entre 10 et 14 points d’indépendance financière au moment de la mise en couple, les hommes, eux, semblent y gagner. Ils passent de 81 % d’indépendance financière lorsqu’ils sont célibataires sans enfant, à 84 % une fois en couple, puis 85 % lorsqu’ils deviennent pères. Tout se passe comme si la conjugalité renforçait la position économique des hommes en même temps qu’elle fragilisait celle des femmes. La mise en couple apparaît ici comme un système à double effet. S’il permet une amélioration du pouvoir d’achat des femmes grâce au partage des dépenses, il conduit également à une mutualisation des revenus du couple, un fonctionnement qui tend à réduire l’autonomie financière des femmes.
Ces disparités trouvent leur source dans des écarts de revenus profondément ancrés. En ruralité, une proportion très majoritaire de femmes (69 %) représentent l’adulte aux revenus minoritaires dans le couple.
Cet écart n’est pas anecdotique et les conséquences sont immédiates : les femmes rurales épargnent moins régulièrement que les hommes et, lorsqu’elles mettent de l’argent de côté, les montants sont plus faibles. Les femmes rurales disposent aussi d’un budget personnel plus restreint pour « se faire plaisir », « améliorer leur quotidien » ou « épargner pour leurs enfants ».
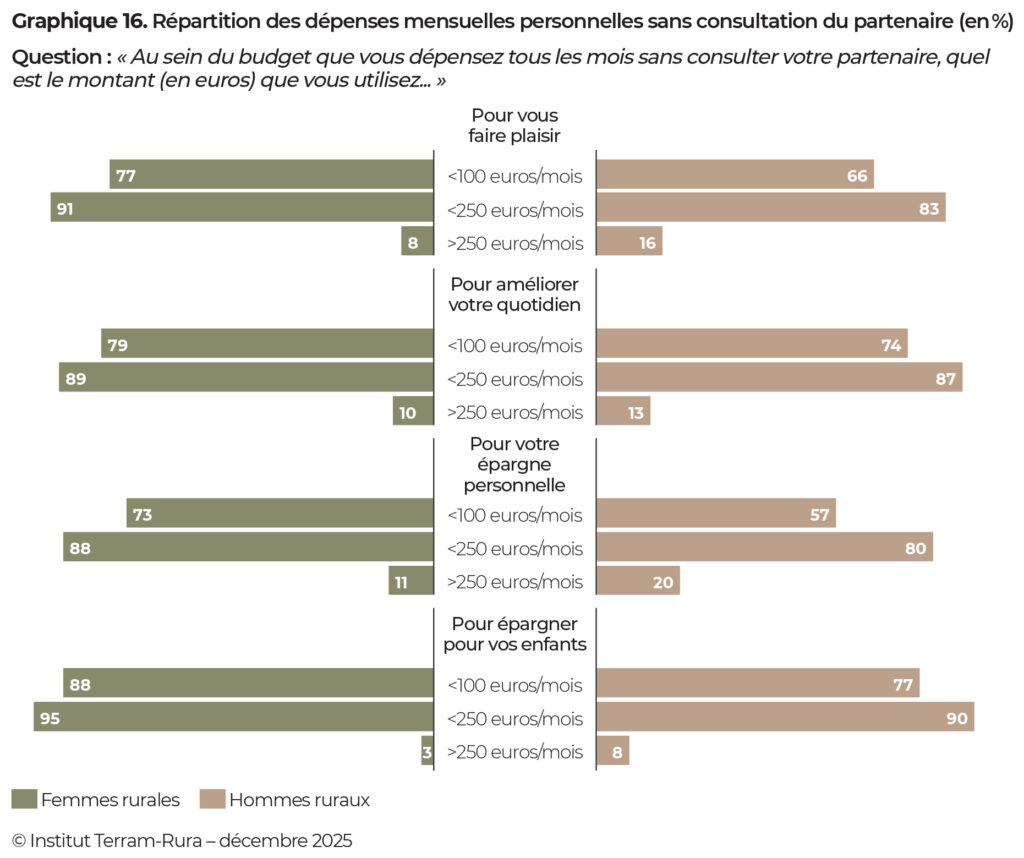
b/ Répartition genrée des dépenses et inégalités patrimoniales
Au-delà des revenus et de l’épargne, les inégalités économiques au sein des couples ruraux se jouent aussi sur la répartition des dépenses et plus encore dans la nature même de ces dépenses. On le sait, traditionnellement, compte tenu de la répartition genrée des rôles au sein d’un couple, les femmes assument davantage les « petites dépenses » : courses, fournitures, achats domestiques courants, dépenses de santé des enfants, cadeaux, frais scolaires, consommables divers. Elles subventionnent, en somme, le fonctionnement quotidien du foyer. Les hommes, eux, sont plus souvent associés aux décisions structurantes : investissements immobiliers, travaux, achat de véhicules, contrats d’assurance ou placements financiers. L’une remplit le frigo, l’autre contracte l’emprunt immobilier. L’une achète les vêtements des enfants, l’autre choisit le modèle de la voiture familiale.
Cette dissymétrie relève non seulement de pratiques, mais aussi de logiques patrimoniales. Les revenus féminins, largement absorbés par les dépenses courantes, s’évaporent au fil du temps et ne s’accumulent pas. Les revenus masculins, eux, sont plus fréquemment orientés vers des biens durables et revendables. Les dépenses masculines, contrairement à celles des femmes, deviennent des investissements. Si une maison ou une voiture se revendent, c’est moins souvent le cas pour un pot de yaourt32Voir Titiou Lecoq, op. cit..
Selon Odile Ezerzer, directrice Finance Épargne Macif et membre de Parité Assurance, « Pour chaque femme, les écarts de revenus accumulés tout au long de la vie vont obérer la capacité d’épargne et se traduire par un patrimoine naturellement inférieur à celui des hommes lors du départ en retraite. La persistance d’écarts de rémunération défavorables aux jeunes filles fera donc ressentir ses effets dans des dizaines d’années. Et ce, malgré une formation académique et une capacité d’intégration au marché du travail supérieures. »33Odile Ezerzer, « Des inégalités de revenus dès le démarrage », in Revenus, épargne, patrimoine des femmes. Les pistes pour réduire les inégalités de genre, juin 2024, p. 17-19.
En ruralité, ces mécanismes se retrouvent dans l’accès aux biens matériels. À première vue, les taux de propriété sont élevés et relativement proches entre femmes et hommes vivant en couple : 80 % des femmes rurales en couple sont propriétaires de leur logement (contre 84 % des hommes), 89 % possèdent un véhicule (contre 94 % des hommes). Les taux de détention de résidences secondaires sont similaires (23 % pour les femmes, 22 % pour les hommes). Cette apparente symétrie masque pourtant une réalité profondément asymétrique : ce n’est pas tant la possession commune qui révèle l’inégalité, mais la possession exclusive.
Or, dès que l’on examine la propriété exclusive du logement, soit l’actif le plus valorisé et le plus déterminant dans la sécurisation des trajectoires, les différences se creusent nettement. Les hommes ruraux sont 24 % à être propriétaires exclusifs de leur logement lorsqu’ils sont en couple sans enfant, 6 points de plus que les femmes dans la même situation (18 %). Lorsque le couple a des enfants, l’écart devient spectaculaire : 35 % des hommes sont propriétaires exclusifs du logement, soit 14 points de plus que les femmes (21 %).
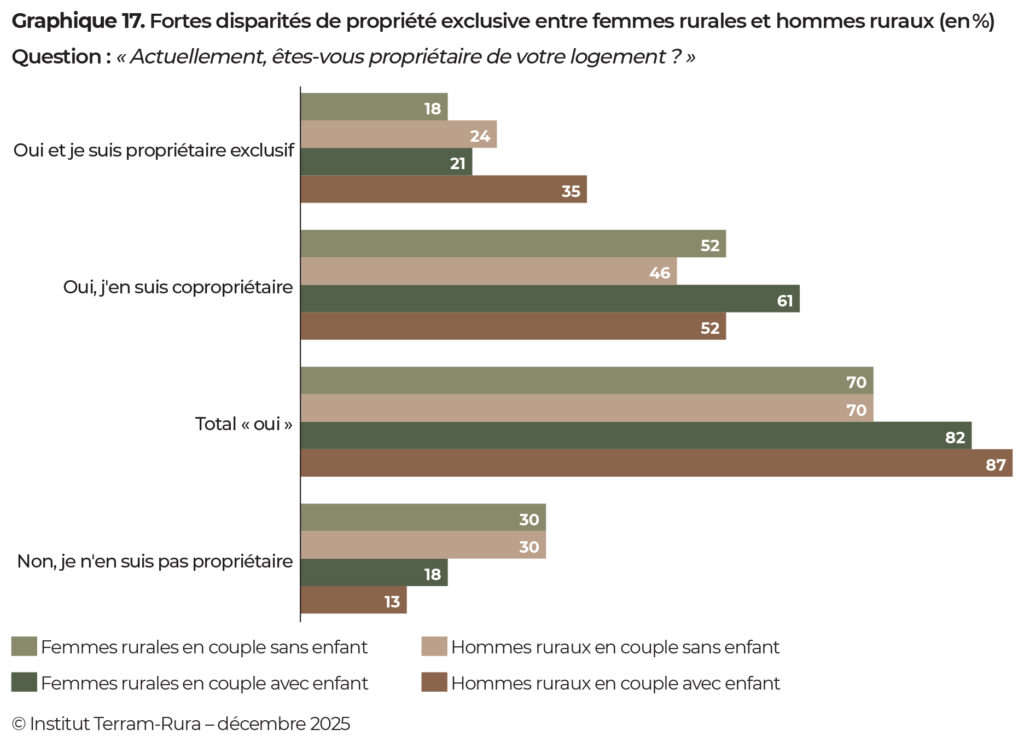

c/ Isolement territorial et vulnérabilité en cas de séparation
L’effet de lieu apparaît encore plus clairement lorsque l’on observe les trajectoires résidentielles. Beaucoup de femmes rurales se mettent en couple dans le village de leur conjoint parce que ce dernier est, le plus souvent, celui qui hérite d’une maison, trouve plus rapidement un emploi local ou bénéficie d’un ancrage ancien34Voit Benoît Coquard, op. cit.. Les femmes rejoignent alors les groupes d’appartenance – famille, amis d’enfance, « bande de potes »… – de leur compagnon. Leur insertion relationnelle repose donc sur un capital d’autochtonie d’emprunt, plus fragile, plus récent, moins immédiatement reconnu.
Cet ancrage différé a des effets sur le sentiment d’isolement. Les femmes rurales sont plus nombreuses que les hommes à se sentir isolées : 79 % en moyenne, contre 72 % des hommes. L’écart grimpe encore dans les couples : 85 % des femmes rurales en couple sans enfant se déclarent isolées, contre 70 % des hommes dans la même situation. Même tendance lorsque des enfants sont présents : 77 % des femmes se disent isolées, contre 66 % des hommes.

Pris séparément, ce sentiment d’isolement pourrait sembler secondaire. Mais replacé dans la trajectoire des femmes rurales, moins rémunérées, plus souvent en retrait professionnel, davantage exposées aux dépenses domestiques, moins propriétaires en titre, davantage dépendantes économiquement du couple, il apparaît comme un maillon d’un système inégalitaire. Un système où les contraintes territoriales – éloignement des services, faiblesse des transports, entre-soi social, dépendance automobile… – amplifient les contraintes de genre déjà existantes. Ces dynamiques se révèlent dans un indicateur décisif : la capacité à faire face seule dans le cas d’une séparation. Ainsi les femmes rurales sont-elles 27 % à déclarer qu’elles ne pourraient pas s’en sortir seules après une rupture, contre 9 % des hommes ruraux. Même comparées aux femmes urbaines en situation similaire (21 %), les rurales apparaissent plus vulnérables encore.
Le système produisant l’isolement des femmes rurales et leur vulnérabilité économique est capital pour comprendre et combattre certaines externalités dramatiques. Les territoires ruraux concentrent en effet 47 % des féminicides, pour un tiers des femmes. Pourtant, seuls 26 % des appels au 391935Le 3919 Violences Femmes Info constitue le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement…). Il propose une écoute, il informe et il oriente vers des dispositifs d’accompagnement et de prise en charge. Ce numéro garantit l’anonymat des personnes appelantes. viennent de la campagne. Un paradoxe qui n’est qu’apparent, favorisé par ce système d’isolement et de relégation hors de l’espace public visible. L’absence d’anonymat et les distances éloignent en outre les femmes rurales des structures de protection et rendent le recours à l’aide plus coûteux, plus risqué, plus rare. Les femmes rurales paient alors un double tribut, au patriarcat et aux inégalités territoriales.
III. Considérer la condition féminine rurale : un impératif pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes
1. La condition féminine comme clé de lecture des vulnérabilités rurales
a/ Genre et ruralité : un double verrou que les dispositifs peinent à desserrer
Les inégalités qui s’imposent aux femmes rurales ne sont pas apparues ex nihilo. Elles sont le fruit des inégalités sociales, territoriales et de genre présentes dans la société française. Elles s’enracinent dans les fragilités économiques que vit une large proportion des ruraux, sont nourries par les kilomètres à franchir, sont structurées par le patriarcat et ce qu’il induit de foncièrement inégalitaire pour les femmes. Ce qui transparaît très clairement dès lors que l’on articule les données et les récits des femmes rurales, c’est que les contraintes propres à la ruralité ne se contentent pas de s’ajouter aux inégalités de genre. Elles les amplifient, les rigidifient et les rendent parfois structurellement inextricables.
Les trajectoires professionnelles des femmes rurales en constituent une des démonstrations les plus éclairantes. Dans les zones peu denses, les données du recensement de 2020 de l’Insee montrent une proportion sensiblement plus élevée de femmes inactives ou faiblement insérées sur le marché du travail que dans les autres territoires36Insee, « Emploi, activité et chômage selon la densité des territoires », recensement de la population 2020-2022.. Cette moindre participation féminine à l’emploi est la matérialisation statistique d’une succession de défis désormais mieux documentée : éloignement des bassins d’emploi, faible diversification des postes accessibles, mobilités coûteuses, absence de solutions de garde, poids des normes familiales et de genre. L’accès à un emploi rémunérateur, à temps plein et stable pour les femmes rurales, s’avère un parcours d’obstacles qui rend ces dernières plus vulnérables face à l’insécurité économique et aux inégalités de genre. Ainsi se met en place un cercle vicieux où les empêchements s’imbriquent. À la fin, l’inégalité de genre nourrit l’inégalité territoriale, qui renforce à son tour l’inégalité de genre.
Les politiques publiques d’égalité entre les femmes et les hommes existent, parfois même depuis longtemps. Mais elles ont la plupart du temps été conçues avec pour référentiel les enjeux de femmes vivant dans des territoires denses, équipés, maillés par les services publics, des entreprises et des associations. Cette géographie urbaine comme cadre conceptuel de référence n’est presque jamais interrogée tant elle demeure inscrite dans l’imaginaire politique et administratif français. Elle conduit à produire des mesures qui prônent l’égalité femmes-hommes, mais ne permettent pas de la rendre effective pour les femmes des campagnes, faute de prise en compte de leur contexte de vie. Ce ne sont pas tant les intentions ou le droit qui manquent, que des moyens adaptés pour le faire advenir de manière tangible.
Ce décalage apparaît dans la structure même des dispositifs de lutte contre les inégalités femmes-hommes. Nombre d’entre eux reposent sur des permanences physiques, des horaires fixes, des interlocuteurs spécialisés et disponibles, ou encore sur une logique d’accompagnement fondée sur la proximité institutionnelle. Or ces éléments se fragilisent dans les zones rurales. Les plages d’ouverture sont réduites, souvent sur les horaires où les femmes travaillent elles aussi, rendant impossible leur accès sans prendre au moins une demi-journée de congé. Les services spécialisés existent peu, car sont jugés trop coûteux face au nombre d’usagères en local. Le temps de trajet pour accéder aux institutions et le coût de ce déplacement pèsent souvent aussi dans la balance. Dans ce contexte, un dispositif qui vise à lutter contre les inégalités, s’il est en théorie mobilisable, s’avère en pratique inaccessible37Voir Émilie Agnoux et Émilie Nicot, op. cit..
b/ La surcharge féminine, facteur silencieux de fragilisation sociale
On l’a vu, les femmes rurales occupent une place centrale dans l’organisation sociale du quotidien. À l’échelle de leur commune, elles animent les associations éducatives, culturelles ou sportives, organisent les fêtes locales, les manifestations scolaires, encadrent les activités périscolaires, soutiennent les démarches administratives des plus fragiles, assurent l’interface entre familles, institutions et acteurs sociaux. Dans les territoires ruraux, nombreuses sont celles qui pallient les retraits des services publics ou l’éloignement des services privés, qui transmettent les réseaux de sociabilité intergénérationnels. Leur engagement constitue l’infrastructure logistique, affective et relationnelle de la ruralité.
Mais cette contribution repose sur une équation dont le résultat n’est pas durable : plus les femmes pallient les manques institutionnels, plus elles absorbent un volume de responsabilités. Ces responsabilités prises pour le collectif se font sans bruit, sans rétribution ou compensation, parfois même sans reconnaissance. Pourtant, la charge mentale et organisationnelle occasionnée n’est pas neutre et la capacité des femmes rurales à gérer de front les enjeux familiaux, professionnels et communautaires n’est pas infiniment extensible. Lorsque cette charge devient excessive, c’est toute la dynamique sociale qui se déséquilibre, révélant à quel point ces apports conditionnent le fonctionnement collectif.
Ce phénomène est documenté par la littérature scientifique : la participation civique n’est jamais un pur reflet de l’intérêt ou de la volonté38Voir notamment Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman et Henry E. Brady, Voice and Equality. Civic Voluntarism in American Politics, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1995.. Elle dépend du sentiment d’efficacité civique, c’est-à-dire de la conviction de pouvoir agir utilement. Or cette conviction s’effrite lorsque le temps, les ressources matérielles ou la disponibilité mentale viennent à manquer. S’enclenche alors pour les femmes rurales une cascade de renoncements : moins d’assiduité aux assemblées associatives, moins de présence aux comités d’école, moins de moments informels au sein du village, moins de relais entre les générations. Ces micro-absences finissent par redessiner et fragiliser la vie collective elle-même. Alors que les élections municipales de 2026 vont pour la première fois demander aux 24 470 communes de moins de 1 000 habitants une parité des listes pour lutter contre la moindre représentation féminine39« Les conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants ne comptent que 37,6 % de femmes (contre 48,5 % dans les communes plus peuplées). Or, ces petites communes représentent 70 % des communes françaises » (Léna Jabre et Romain Gaspar, « Municipales 2026 : l’extension de la parité dans toutes les communes », La Gazette des communes, 22 mai 2025, en ligne sur lagazettedescommunes.com)., questionner la surcharge féminine à la campagne semble être un impératif à l’existence d’une parité réelle40Benjamin Morel, Conseils municipaux : renouer avec l’engagement citoyen, Institut Terram-Laboratoire de la République, août 2025..
c/ L’égalité numérique à l’épreuve : double peine des obstacles d’accès et des biais algorithmiques
Si la géographie impose de parcourir des kilomètres pour accéder à un service public ou privé, le numérique peut, en théorie, réduire cette distance à presque rien. Mais la dématérialisation, non accompagnée d’un soutien humain accessible, fonctionne à son tour comme un filtre. Dans des territoires ruraux où les connexions restent parfois instables, où les compétences numériques varient fortement et où l’on ne peut compenser l’absence d’un service local par une simple hotline située à plusieurs centaines de kilomètres, la numérisation devient une réponse incomplète, parfois même un élément aggravant. Ce n’est pas l’outil numérique en soi qui pose problème, mais son incapacité à remplacer l’interlocuteur compétent, immédiatement joignable, capable de résoudre une situation concrète et localisée.
De surcroît, la dématérialisation ne pourra jamais remplacer un accès aux soins, un accès à l’éducation ou à toute autre matérialisation concrète de l’importance que l’État accorde aux ruraux. Si 83 % d’entre eux déclarent avoir facilement accès à un bureau de poste et que La Poste a maintenu 17 000 de ses bureaux pour être accessible à moins de vingt minutes de 9 Français sur 10, la fermeture de certains bureaux demeure particulièrement corrélée au sentiment d’abandon institutionnel vécu par les ruraux41Voir Destin commun-Bouge ton coQ-inSite-Rura, op. cit..
Aux difficultés d’accès numérique s’ajoute un enjeu plus récent et tout aussi structurant : celui des biais algorithmiques42Voir Aurélie Jean et Jean-Baptiste Manenti, IA et inclusion algorithmique : un enjeu de cohésion sociale, économique et territoriale, Institut Terram, septembre 2025.. Les modèles d’IA sont en effet majoritairement entraînés sur des données urbaines, abondantes, standardisées, fortement documentées. À l’inverse, les réalités rurales, plus hétérogènes, moins volumineuses et rarement intégrées comme catégories d’analyse sont souvent mal représentées. Lorsque cette sous-représentation territoriale se combine aux biais déjà bien établis concernant les femmes (poids moindre dans les jeux de données, classifications professionnelles biaisées, reproduction de stéréotypes dans les systèmes de recommandation), il ne s’agit plus seulement d’invisibilisation : les femmes rurales deviennent statistiquement déformées, perçues à travers des modèles qui ne correspondent ni à leurs situations, ni à leurs besoins, ni à leurs trajectoires. Ces distorsions peuvent avoir des conséquences très concrètes, qu’il s’agisse d’une orientation professionnelle inadaptée, d’une détection insuffisante des situations de vulnérabilité, d’une priorisation erronée des besoins sociaux ou encore de la conception de services numériques fondés sur des usages exclusivement urbains.
d/ Le ressentiment rural : matrice du vote protestataire et miroir des fragilités féminines
La fragilisation de la vie locale n’est pas seulement une affaire de dynamiques internes aux campagnes. Elle alimente la prophétie autoréalisatrice d’une France fracturée entre territoires ruraux et grandes métropoles. Nombre de ruraux ont le sentiment que la cohésion s’effrite ici pendant qu’elle se recompose ailleurs. L’idée d’un pays qui avance à plusieurs vitesses, où la ruralité tiendrait lieu de dernière roue du carrosse, s’installe et s’enracine.
À cela s’ajoute une asymétrie persistante dans les représentations. Alors que les habitants des zones peu denses ont le sentiment d’être mal compris et considérés, le regard venu des centres urbains demeure trop fréquemment imprégné de clichés, d’incompréhensions ou de condescendance diffuse. Au mieux, on ne sait pas penser les campagnes ; au pire, on les relègue au rang de périphéries, assignées à un rôle symbolique ou nostalgique plutôt qu’à une réalité sociale et politique pleinement vivante.
Les inégalités de genre vécues par les femmes rurales s’inscrivent dans ce climat. Elles participent du « ressentiment rural », qui les touche avec une intensité particulière. Comme l’a montré la politiste américaine Katherine Cramer, le ressentiment rural repose sur trois dimensions imbriquées :
- une perception de désavantage politique, c’est‑à‑dire l’impression que les décisions publiques se prennent ailleurs ;
- une injustice économique, fondée sur la conviction de ne pas recevoir une part équitable des ressources collectives ;
- une dévalorisation culturelle, nourrie par l’idée que leur mode de vie est mal compris, mal représenté, parfois déprécié43Voir Katherine Cramer, The Politics of Resentment. Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker, Chicago, University of Chicago Press, 2016..
Ce cadre éclaire les ressentis exprimés par de nombreuses femmes interrogées ici, celui d’un décalage croissant entre les efforts consentis au quotidien et la reconnaissance qui leur est accordée par la société dans son ensemble. Quand ces perceptions s’ajoutent aux inégalités de genre, elles risquent de créer un empilement d’expériences de déconsidération et de mépris. Comme si la situation inégalitaire que ces femmes rencontrent était un état de fait, considérée par d’autres comme naturelle et immuable.
En France, le ressentiment rural se manifeste avec une intensité comparable à celle observée aux États‑Unis. Les données récentes le confirment :
- 81 % des ruraux estiment que les politiques accordent trop d’importance aux préoccupations des villes ;
- 76 % considèrent que les campagnes donnent plus qu’elles ne reçoivent en retour ;
- 81 % jugent que les urbains ne comprennent ni ne respectent leur culture ou leur mode de vie44Voir Destin commun-Bouge ton coQ-inSite-Rura, op. cit., p. 7-8..
Une telle perception globale d’injustice prend rapidement des formes politiques. Les dynamiques électorales récentes témoignent d’un basculement profond. Aux élections législatives de 2024, le Rassemblement national (RN) atteint ses scores les plus élevés dans les territoires ruraux, autour de 42 %, contre environ 30 % en zones urbaines. Près de 70 % de ses électeurs résident dans des communes de moins de 10 000 habitants45Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, Comprendre la géographie du vote RN en 2024, Institut Terram, septembre 2024, p. 12..
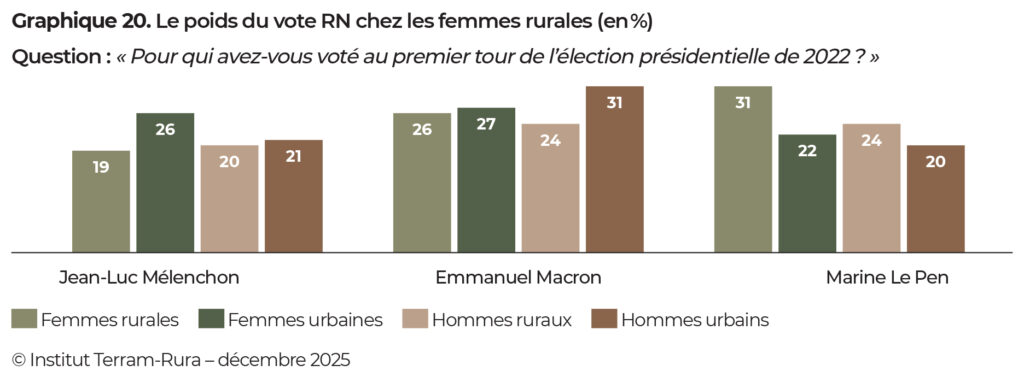
Dans ces territoires, les femmes les plus fragilisées – économiquement, socialement ou familialement – se tournent vers le RN. Chez elles, le vote n’est pas systématiquement une adhésion idéologique. Il peut relever d’une quête de stabilité, de protection, de reconnaissance et parfois de respectabilité 46, dans un environnement où les perspectives professionnelles, financières et sociales peuvent être limitées. L’écart de genre, longtemps défavorable au RN, s’est résorbé partout, notamment dans les zones peu denses.
Enfin, beaucoup de femmes rurales expriment un sentiment d’invisibilisation institutionnelle. Les politiques publiques dédiées aux territoires ruraux intègrent encore très imparfaitement leurs réalités. À titre d’exemple, aucune des 181 mesures de l’Agenda rural de 2019 ne mentionnait explicitement l’égalité femmes-hommes. Cette omission, partiellement corrigée depuis, notamment grâce aux 70 recommandations de la délégation aux droits des femmes du Sénat, a pourtant laissé une empreinte durable : celle d’une cécité structurelle. Une impression que le quotidien des femmes rurales demeure à la fois vu de loin et pensé d’ailleurs. Dans ce contexte, les offres politiques qui promettent écoute, protection ou reconnaissance peuvent apparaître comme des voies de réparation symbolique possibles, voire souhaitables.
e/ De la théorie des droits à leur effectivité : faire de l’accessibilité le véritable critère de l’égalité
En ruralité, la question centrale n’est pas tant celle de l’existence du droit que celle de la capacité à l’exercer46Voir Annick Billon, « Proposition de résolution appelant à une meilleure prise en compte de la situation des femmes dans les territoires ruraux pour en finir avec les zones blanches de l’égalité », texte n° 76 (2024-2025), Sénat, 24 octobre 2024.. Penser l’égalité suppose de se poser des questions simples et qui ne sont pourtant pas toujours posées : qui pourra réellement utiliser le dispositif, à quelles conditions et avec quel coût d’accès (temporel, financier, organisationnel, symbolique) ? Car, on l’a vu, dans la vie des femmes rurales, chaque prise de décision se traduit par une réorganisation domestique, un trajet supplémentaire, un arbitrage entre obligations professionnelles, familiales, distances, coût financier et disponibilité du véhicule. C’est lorsque ces effets ne sont pas anticipés que l’inégalité se développe.
L’enjeu n’est bien évidemment pas de multiplier les outils estampillés « ruralité », mais de rendre accessibles les dispositifs existants pour les femmes rurales. Cela implique des points d’entrée clairs, identifiables, ouverts à horaires compatibles avec les réalités professionnelles et familiales et capables d’assurer une continuité d’accompagnement malgré l’éloignement. Dans ce cadre, chaque territoire, chaque institution, chaque collectivité, doit développer une logique « d’aller vers ». Seule cette logique permet d’adapter la présence et la proximité des services aux réalités des femmes rurales. Dès lors que les services se déplacent – via des permanences mobiles, des bus de santé, des antennes juridiques itinérantes, des dispositifs d’accompagnement en multisites –, l’accès s’ouvre à celles qui renonceraient faute de temps, de ressources ou de solution de mobilité.
Mais cette adaptation ne peut fonctionner seule. Elle se doit d’être accompagnée d’un changement de regard sur la ruralité et celles qui y vivent. À l’échelle nationale, il est essentiel de considérer enfin la ruralité comme un ensemble cohérent. Un ensemble qui représente un tiers de la population et partage un certain nombre d’enjeux transversaux. Ce changement de regard induit des réponses à la hauteur du nombre de Français concernés et concernées. S’il y a bien 30 775 communes rurales en France, on ne pourra régler les inégalités systémiques vécues par les femmes rurales avec 30 775 budgets municipaux. Les inégalités que vivent les femmes rurales ne sont pas « des histoires de villages ». Elles sont systémiques et appellent des réponses à la hauteur de l’enjeu.
2. Recommandations : combler les écarts d’accès, consolider la capacité d’agir
Les recommandations suivantes s’appuient sur les échanges menés avec des femmes rurales – élues, engagées associativement, citoyennes… – ainsi que sur des propositions issues des rares travaux récents consacrés au sujet, complétées par l’expertise de l’Institut Terram et de Rura.
a/ Faire évoluer la considération portée aux femmes rurales et la place qui leur est donnée
Moins représentées dans l’espace public, politique, médiatique et culturel, les femmes rurales sont peu souvent en situation d’exprimer leur vécu. Moins étudiées par les sciences sociales que les femmes urbaines et les hommes, les femmes rurales souffrent d’une double relégation statistique.
Il en va de même dans les études de marché et d’opinion. Ruraux et rurales y sont systématiquement sous-représentés, noyés dans des critères de représentativité de genre et de répartition géographique sans que la question de la densité territoriale soit un sous-critère de représentation. Ainsi, dans un échantillon supposé représentatif de la société française, les 11 millions de femmes rurales ne sont pas représentées à la hauteur de leur poids démographique réel, accordant une moindre part à leurs besoins, leurs points de vue ou leurs habitudes de consommation. En découlent des politiques publiques, des dispositifs d’égalité femmes-hommes développés dans les entreprises, des parcours d’accès et d’accompagnement des institutions en zones rurales qui prennent rarement en considération les enjeux spécifiques des rurales et qui manquent souvent leurs objectifs d’impact.
PRÉCONISATIONSMassifier les travaux de recherche sur les femmes rurales. Par le financement proactif de champs de recherche qui les thématisent, dans la lignée des quelques travaux de sociologie et d’économie constituant la bibliographie de cette étude. Cette massification des travaux de recherche doit permettre une meilleure compréhension des vécus et enjeux des femmes rurales, dans toute leur diversité.
Concevoir les politiques publiques et les dispositifs d’égalité femmes-hommes privés en se fondant sur le vécu des femmes rurales célibataires avec enfant. Considérer les femmes rurales célibataires avec enfant, extreme users de la condition féminine, comme l’un des persona de base pour la conception des dispositifs publics permettrait de prendre en considération l’ensemble des enjeux et des empêchements vécus intensément par ce public et partagés, parfois dans une moindre mesure, par toutes les femmes. Cette approche par une conception universelle permettrait aux dispositifs d’être utilisés par toutes les femmes, sans nécessiter ni d’adaptation ni de conception spéciale, quels que soient le territoire, la situation matrimoniale, la situation économique ou la capacité à se déplacer.
Faire de la densité du territoire de résidence un critère de représentativité dans les enquêtes d’opinion et les études de marché. Considérer ce critère comme un critère de représentativité obligatoire au sein des sondages, des enquêtes d’opinion et des études de marché permettrait de considérer les habitants des territoires ruraux comme un public à analyser selon une grille spécifique pour étudier le vécu des femmes rurales en croisant ce nouveau critère avec un critère de sexe, déjà présent dans toutes les populations statistiques représentatives.
Promouvoir la création culturelle, scientifique et médiatique portée par des femmes rurales. Pour lutter contre l’invisibilisation de leur vécu, à travers la démultiplication de leurs récits, analyses et perceptions, portés par elles-mêmes, au plus proche du réel, dans l’espace public et dans l’imaginaire collectif français.
b/Mobilité, formation, emploi, garde : l’ossature territoriale de la liberté d’agir
De nombreuses femmes, dans des territoires ruraux variés, du nord au sud de la France, d’est en ouest, évoquent des scènes analogues, des empêchements identiques, des témoignages qui se répondent. On leur a suggéré de se rendre dans une maison France Services pour plus d’informations et d’appui dans une démarche administrative. Mais les horaires d’ouverture se superposent avec leurs temps de travail. Et la maison France Services est fermée à l’heure du déjeuner. Elles ont repéré une formation à laquelle elles souhaiteraient candidater. Mais la gare permettant de s’y rendre est à trente minutes. Et leur foyer ne dispose que d’une voiture. Elles aimeraient changer de travail. Mais personne ne recrute à côté de chez elles et les premières entreprises sont à plus de 45 minutes en voiture, soit 12 euros par jour rien que pour le carburant, 5 jours par semaine, soit 230 euros par mois. Étant donné le salaire proposé, l’équation n’est pas tenable. De toute façon, à cette distance, elles ne pourraient jamais être rentrées à temps pour récupérer leur fille chez l’assistante maternelle.
Ces situations ne relèvent pas de détails logistiques individuels. Elles dessinent la frontière réelle et collective entre ce qui pour une femme rurale est possible et ce qui ne l’est pas. Des études récentes montrent que près d’un jeune rural sur deux déclare avoir renoncé à une formation ou un emploi faute de solution de transport47Voir Félix Assouly, Salomé Bérioux et Victor Delage, op. cit.. Ce renoncement initial n’est pas un accident. Il conditionne les trajectoires professionnelles, la stabilité de l’emploi, les opportunités d’évolution, les choix familiaux.
Comme nous le détaillons dans cette étude, le manque de solutions de garde renforce encore ce verrou structurel pour les femmes des campagnes. Les familles rurales disposent en moyenne de trois fois moins de places en crèche accessibles rapidement que les familles urbaines48Voir « Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l’égalité », rapport d’information n° 60 (2021-2022), Sénat, 14 octobre 2021., ce qui transforme la moindre contrainte horaire en casse-tête. Le lien entre mobilité et garde est ici décisif : sans solutions pour l’un, les solutions pour l’autre perdent leurs effets. Là encore, l’enjeu n’est pas la volonté individuelle, mais l’architecture territoriale dans laquelle s’inscrit le quotidien des femmes. Si l’on veut qu’elles puissent envisager des parcours académiques et professionnels aussi libres et ouverts que ceux des femmes urbaines, aussi libres que ceux des hommes ruraux, il faut investir dans les conditions mêmes de cet accès. Afin de rétablir les continuités qui permettent à l’égalité d’exister véritablement.
PRÉCONISATIONS
Faire de l’éloignement géographique un critère d’accès aux dispositifs d’aide publics. Pour les jeunes rurales, choisir un parcours d’orientation après le collège et plus encore après le bac nécessite souvent de quitter le domicile familial. L’accès à des aides sociales comme la prime d’internat ou la bourse sur critères sociaux est en ce sens déterminant pour les jeunes éloignés des grandes métropoles. Ces aides gagneraient à mieux prendre en compte l’isolement géographique de ces jeunes filles majoritairement issues de milieux populaires et la complexité économique que représente un départ pour étudier.
Installer l’offre de formation au plus près. En complémentarité des efforts menés pour résorber les inégalités territoriales dans les parcours des jeunes filles par des dispositifs facilitant la mobilité, il convient aussi de développer des dispositifs en ruralité. Les campus connectés doivent être multipliés dans les bourgs structurants. Des sessions qualifiantes itinérantes, ciblées sur les métiers en tension (santé, aide à la personne, petite enfance, artisanat qualifié…), doivent être organisées régulièrement. L’accompagnement Validation des acquis de l’expérience (VAE) doit être renforcé, en particulier pour les femmes sans solution de mobilité. Les employeurs locaux peuvent être incités à coorganiser des formations sur site, via des conventions territoriales.
Déployer des solutions de mobilité adaptées aux rythmes réels de vie et permettant une moindre dépendance à la voiture individuelle et aux coûts qu’elle induit. Cela implique de structurer un transport à la demande à l’échelle intercommunale, avec des horaires compatibles avec les emplois féminins, de créer des lignes de rabattement vers les bassins d’emploi et de soutenir durablement les garages solidaires et auto-écoles sociales. Les plateformes locales de covoiturage doivent être professionnalisées, avec des points d’arrêt fixes, identifiés, sécurisés et adaptés aux horaires scolaires.
Croiser systématiquement mobilité et garde. Au-delà de débloquer des financements permettant de développer l’offre de garde publique à la campagne, les modes d’accueil doivent être rapprochés des lieux de travail ou des bourgs-services, avec des micro-crèches, des maisons d’assistantes maternelles ou des lieux passerelles offrant des horaires élargis (tôt le matin, tard le soir, le week-end). Un financement dédié pour l’accueil des enfants en horaires atypiques, largement utilisés par les professions féminisées, est indispensable.
Créer des « référentes mobilité-emploi » à l’échelle intercommunale. Ces agentes, formées aux enjeux d’insertion professionnelle spécifiques des femmes rurales, auraient pour rôle d’accompagner personnellement les femmes dans la construction de leur parcours de vie, incluant mobilité, garde, formation et emploi. Elles représenteraient un point d’entrée unique, capable d’articuler l’ensemble des contraintes
Créer un « crédit mobilité-formation » pour les femmes rurales. Ce dispositif expérimental pourrait financer des trajets, des abonnements, des réparations de véhicules, du covoiturage structuré ou des nuits en hébergement ponctuel pour suivre une formation éloignée. Le reste à charge de la mobilité reste aujourd’hui un frein à la formation.
c/ Accès au crédit et autonomie financière : les ressorts économiques de l’indépendance
L’indépendance financière des femmes rurales ne se mesure pas uniquement aux revenus perçus. Elle dépend largement des conditions matérielles d’accès aux services financiers, aux conseils juridiques, aux dispositifs de crédit et aux possibilités d’investissement. L’autonomie économique n’est donc pas un principe abstrait, mais bien une réalité qui doit se frayer un chemin entre les contraintes du quotidien et les espaces moins denses de la vie financière rurale.
La première limite vient de la réduction progressive de l’offre financière de proximité. Avec la fermeture d’agences bancaires ou la diminution des permanences notariales, il n’est pas rare que les femmes rurales doivent parcourir de longues distances pour faire réviser un contrat. Cet éloignement géographique a un effet particulièrement discriminant : plus la distance augmente, plus la probabilité de solliciter un conseil diminue.
À ces contraintes territoriales, s’ajoutent les caractéristiques des trajectoires professionnelles féminines en ruralité. Les emplois y sont plus fréquemment à temps partiel, discontinus ou saisonniers, avec des salaires médians plus faibles. Ce ne sont pas des singularités individuelles, mais les effets structurels d’un marché du travail moins diversifié. Or les critères bancaires reposent largement sur la stabilité du revenu, la régularité des contrats, voire la projection d’évolution professionnelle. De ce fait, les femmes rurales voient souvent leurs demandes de crédit fragilisées par la structure économique de leur territoire, davantage que par leur comportement budgétaire ou leur capacité réelle à gérer un emprunt.
Cette difficulté apparaît encore plus nettement lors des épisodes de rupture de vie (séparation, divorce ou veuvage) qui constituent des moments critiques pour l’autonomie financière des femmes. Dans les espaces peu denses, l’accès à une information fiable et rapide sur les droits patrimoniaux, les démarches en cas de séparation, les mécanismes de protection financière (contrats d’assurance, renégociations de prêts, aides spécifiques) n’est pas continu. Là où les villes disposent de permanences juridiques, d’associations spécialisées ou de services de médiation accessibles en quelques stations de transport, les campagnes doivent compter sur des rendez-vous espacés, souvent éloignés géographiquement, et parfois sur un unique acteur pour plusieurs communes. Enfin, le virage numérique des services financiers, s’il ouvre certaines possibilités, génère aussi des écarts supplémentaires. La dématérialisation ne compense pas l’absence d’interlocuteur spécialisé. Et les modèles automatisés – algorithmes de scoring, évaluation prédictive du risque, outils de recommandation… – utilisent rarement des données adaptées aux femmes et aux territoires peu denses.
La condition des femmes rurales les pousse, nous l’avons vu plus tôt, à se sentir structurellement moins en mesure de quitter leur conjoint pour des raisons économiques dans au moins 27 % des cas. Cette donne très prégnante en zones rurales n’est pas prise en considération de manière holistique par les produits bancaires et assurantiels.
PRÉCONISATIONS
Développer une offre financière itinérante, en organisant des permanences de conseillers bancaires, de notaires, de juristes ou de conseillers en gestion budgétaire, capables de couvrir plusieurs communes et d’assurer une présence régulière dans les bourgs.
Former les acteurs bancaires et assurantiels aux biais de genre et aux biais territoriaux dans l’évaluation du risque, afin d’éviter que les particularités professionnelles des femmes rurales soient perçues comme des fragilités structurelles.
Mettre en place un accompagnement patrimonial de proximité, via des permanences intercommunales régulières (séparation, divorce, transmission, création d’activité…), pour sécuriser les moments de vie où les risques de perte d’autonomie financière sont les plus élevés.
Mettre en place un réflexe spécifique des assureurs concernant les femmes rurales lors de l’annonce d’une rupture, en activant des dispositifs d’accompagnement dédiés : cellule d’écoute spécialisée, solutions de relogement transitoire, services d’assistance adaptés, ainsi qu’une orientation vers des partenaires bancaires permettant l’accès à des prêts à très faible taux afin de soutenir le rétablissement de la sécurité économique des femmes après la séparation.
d/ Reconstruire une continuité médicale mise à mal
Dans les campagnes, l’accès à la santé des femmes peut là encore ressembler à un parcours d’obstacles. La raréfaction de l’offre médicale est devenue structurelle : deux bassins de vie ruraux sur trois manquent désormais de médecins généralistes. La situation est encore plus sévère pour les spécialistes, notamment en gynécologie. Près de 63,6 % des femmes déclarent ne pas avoir accès rapidement et facilement à des soins adaptés49Émilie Agnoux et Émilie Nicot, op. cit., p. 2.. Quand l’offre devient aussi erratique, une consultation n’est plus un simple déplacement. Elle se transforme en pari sur le temps disponible, sur la possibilité de libérer une demi-journée ou davantage, sur la chance d’obtenir un créneau à une heure compatible avec la vie familiale.
Cette dynamique pèse particulièrement sur les mères. Là où les pédiatres sont plus rares, les rendez-vous des enfants deviennent prioritaires dans l’organisation domestique. Comme les femmes assurent majoritairement la charge d’organisation familiale, un grand nombre d’entre elles racontent que leurs propres suivis passent après ceux de leurs enfants. Dans les arbitrages du quotidien, la santé préventive devient ce que l’on reporte. Ce que l’on fera « quand ça ira mieux », ou « quand on aura le temps ».
Viennent s’ajouter les fragilités structurelles de la chaîne de soins elle-même. Même lorsqu’un suivi est prescrit, il faut pouvoir l’assurer régulièrement. Sur ce sujet, l’exemple de la santé sexuelle ou reproductive est particulièrement parlant. Lorsque l’accès à des consultations de gynécologie est structurellement complexe, les femmes sont supposées se tourner vers des alternatives de proximité en santé sexuelle ou reproductive (centres de planification, permanences dédiées, consultations de sage-femme…). Cette offre de réseau alternatif reste majoritairement urbaine, ou présente en ruralité seulement quelques demi-journées par mois50Ibid.. Cette géographie inégale rend la contraception, le suivi gynécologique ou les dépistages plus difficiles à maintenir dans la durée. L’inégalité ne se joue donc pas uniquement dans l’accès initial au soin, mais également dans la capacité à sécuriser une continuité de prise en charge.
PRÉCONISATIONS
Encadrer et outiller la téléconsultation lorsqu’elle est pertinente. Pour éviter que la dématérialisation ne devienne un filtre supplémentaire, il convient d’équiper les Maisons France Services, maisons de santé et tiers-lieux, de cabines ou de salles de téléconsultation, accompagnées d’un relais humain formé. Ce soutien est indispensable pour aider aux démarches, sécuriser la compréhension médicale et éviter que les femmes les plus éloignées du numérique ne soient exclues de fait.
Renforcer l’offre de première ligne. La valorisation de l’installation des professionnels dans les zones peu denses, via des incitations financières, un soutien à l’exercice coordonné ou la création de postes de médecins salariés, doit s’accompagner de protocoles de coopération entre médecins, sages-femmes, infirmières et professionnels paramédicaux. Ces coopérations fluidifient l’accès, évitent des déplacements inutiles et garantissent un suivi continu.
Généraliser des dispositifs mobiles de santé des femmes. Le développement de bus itinérants dédiés à la gynécologie, à la prévention et au suivi santé (dépistage, contraception, santé sexuelle…), complétés par des réseaux de sages-femmes itinérantes et des permanences régulières dans les maisons de santé rurales, permettrait d’assurer une présence médicale minimale et stable dans les zones les plus isolées.
Expérimenter des permanences « multiservices santé ». Installées dans les bourgs, elles regrouperaient prévention, consultations courtes, dépistage, vaccination, santé sexuelle et accompagnement social, permettant aux femmes de concentrer plusieurs démarches en un seul déplacement.
Déployer des dispositifs de « rendez-vous protégés ». Il s’agirait d’horaires réservés, adaptés aux réalités rurales (tôt le matin, fin d’après-midi, semaines alternées), garantissant que les femmes qui jonglent avec les horaires scolaires puissent accéder à un suivi régulier sans devoir poser une journée complète.
e/ Violences conjugales : garantir la protection dans un contexte où la proximité rend vulnérable
La lutte contre les violences conjugales est une question de dispositifs existants, mais aussi de conditions d’accès, de visibilité, de confidentialité, d’interconnaissance, de temporalité. Là encore, l’égalité devant la loi peut se heurter à l’inégalité devant la possibilité de l’exercer. C’est dans ce domaine que la ruralité révèle avec le plus de brutalité les angles morts de l’action publique.
En théorie, les droits sont identiques partout. En pratique, demander de l’aide coûte plus cher à la campagne. Davantage de temps, davantage d’énergie, davantage de risques. Dans un territoire où tout le monde connaît tout le monde, aller porter plainte n’a rien de l’anonymat des grandes villes. On craint d’être vue, reconnue, jugée. On redoute que l’agent de gendarmerie auquel on va devoir se confier connaisse notre conjoint ou qu’un membre de notre belle-famille travaille à la mairie. Cette proximité sociale transforme une démarche vitale en exposition publique. Elle explique aussi pourquoi tant de femmes interrogées disent garder pour elles ce qu’elles vivent, par peur de faire éclater un milieu où les réseaux d’interdépendance sont forts et la réputation des femmes essentielle à leur intégration localisée.
Les chiffres rendent tangible cette tension. Comme évoqué plus tôt dans cette étude, les territoires ruraux concentrent près de la moitié des féminicides (47 %). Pourtant, seuls 26 % des appels au 3919 proviennent des régions principalement rurales. Il ne s’agit pas d’une moindre violence, mais d’un moindre recours : l’aide existe, mais elle est plus loin, plus rare, plus visible, moins confidentielle, plus coûteuse à mobiliser51Voir « Femmes et ruralités… », op. cit..
Les trajectoires de recours confirment ce décalage. En ruralité, les femmes victimes se tournent plus souvent vers leur médecin généraliste que vers la gendarmerie ou les associations spécialisées. Le soin devient la première – parfois l’unique – porte d’entrée, non parce qu’il serait plus adapté, mais parce qu’il est plus proche et socialement moins exposé. Cet usage du système de santé comme espace de refuge témoigne d’une réalité : lorsqu’un territoire manque de lieux neutres, c’est dans les lieux du soin que s’incarne le premier soutien52Voir Femmes et ruralité. Pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les territoires ruraux franciliens, Saint-Ouen, Centre Hubertine-Auclert, 2019., même si, désertification médicale oblige, ces derniers sont de plus en plus difficiles d’accès.
Or, lorsque l’on franchit la première étape, la suite s’avère tout aussi complexe : trouver un hébergement éloigné, assurer sa sécurité dans un territoire où les distances sont longues, maintenir le lien avec les enfants, poursuivre les démarches judiciaires. Dans ces conditions, s’extraire des violences n’est pas seulement un processus psychologique, mais un parcours matériel fragile, continuellement menacé par les ruptures d’accès.
PRÉCONISATIONS
Former et outiller les relais de première ligne. Le médecin généraliste, la sage-femme, l’infirmière ou le pharmacien doivent pouvoir identifier rapidement une situation de violence et activer un protocole clair de mise à l’abri. Des modules de formation courts, réguliers, accompagnés d’une fiche réflexe commune à tous les acteurs du territoire, permettraient d’unifier les pratiques et de réduire les ruptures dans la chaîne de protection.
Déployer une offre d’écoute et d’accès au droit en « aller vers » non stigmatisante. Les permanences mobiles juridiques, psychologiques et sociales rapprochent l’aide des femmes et limitent les déplacements à longue distance. Installées dans des lieux du quotidien (maisons de santé, France Services, associations), ces permanences offrent des créneaux sans inscription, adaptés aux contraintes des femmes rurales. L’itinérance, lorsqu’elle est régulière et identifiable, peut augmenter le recours à l’aide. Ces permanences se doivent d’être multithématiques dans l’accompagnement à l’accès aux droits. Cet aspect de guichet multiservice permet aux utilisatrices potentielles de s’y rendre en limitant la surveillance, le contrôle social et la stigmatisation potentielle.
Garantir des modalités de signalement et de plainte réellement confidentielles. Dans l’interconnaissance rurale, la confidentialité est décisive. La possibilité de déposer plainte dans un autre bassin de vie, sur rendez-vous, ou lors de tournées itinérantes des forces de sécurité limite la peur d’être vue ou reconnue. L’accompagnement suite à un premier contact par une référente formée sécurise le parcours des femmes rurales et réduit les abandons de démarche.
Structurer une communication locale claire et continue. De nombreuses femmes ignorent les ressources disponibles. Une information régulière, relayée par les canaux concrets des territoires (mairies, cabinets médicaux, écoles, pharmacies, commerces, 3919…), réduit le non-recours. Dans certains territoires, un affichage discret mais systématique dans les lieux du quotidien peut se révéler décisif.
Sécuriser un financement pluriannuel des associations spécialisées et de leurs antennes mobiles. Les associations spécialisées dans l’information, l’accompagnement et la mise à l’abri des femmes constituent l’ossature de la prise en charge, mais leur présence rurale reste fragile. Des financements pluriannuels garantissent la stabilité des équipes, la continuité de l’itinérance et un accompagnement durable. Sans ces fondements, les dispositifs demeurent précaires et les parcours des femmes discontinus.
Former élus, agents d’accueil, forces de sécurité et acteurs éducatifs aux spécificités rurales des violences. Comprendre l’interconnaissance, les réseaux familiaux locaux, la faible confidentialité et les risques de rumeur est indispensable pour accueillir durablement la parole des victimes. Des formations régulières, accompagnées de la désignation de référentes par bassin de vie, renforcent la cohérence territoriale et la capacité à agir rapidement.
Déployer un maillage fin d’hébergement d’urgence. L’éloignement des places d’urgence est l’un des premiers obstacles à la sortie des violences. Des petites unités sécurisées au plus près des territoires, complétées par des logements-relais intercommunaux et un relogement prioritaire après la mise à l’abri, permettent de sécuriser les femmes sans les déraciner ni les exposer à des déplacements impossibles.
f/ Familles monoparentales : le cumul des vulnérabilités dans un environnement exigeant
Les familles monoparentales, au sein desquelles l’unique parent est en très grande majorité une femme, se trouvent au croisement de plusieurs fragilités structurelles en ruralité. Avec des revenus en moyenne plus faibles et un patrimoine financier moins important, mais aussi l’absence du second adulte pour partager les charges domestiques, ces configurations mettent les femmes rurales célibataires avec enfant dans une situation de fragilité économique particulièrement marquée.
Lorsque ces femmes vivent au coeur d’une grande ville, où leur domicile, leur travail et les services publics et privés sont plus concentrés, cette situation de monoparentalité a des effets certains. Ils sont toutefois de nature et souvent d’intensité différentes dans les zones rurales, où chaque déplacement demande un véhicule, où chaque retard de car scolaire, chaque maladie d’enfant, chaque rendez-vous chez le médecin chamboulent l’ensemble de la semaine du fait des kilomètres à parcourir. Et le moindre imprévu peut avoir un coût, notamment professionnel, pour les femmes, a fortiori quand elles sont seules.
PRÉCONISATIONS
Renforcer les dispositifs d’accompagnement dédiés. Avec des référents sociaux identifiés pour les familles monoparentales rurales, capables d’assurer un suivi continu malgré la dispersion géographique.
Soutenir la mobilité des familles monoparentales. Ce soutien via des aides ciblées (financement du permis, remise en état d’un véhicule, achat d’une voiture fiable…) constitue un levier d’autonomie décisif pour les familles monoparentales. Articulées avec les garages solidaires et les microcrédits sociaux, elles permettent de sécuriser une mobilité sans laquelle aucune insertion durable n’est possible.
Développer des solutions de garde d’enfants ciblées. En privilégiant des horaires élargis, des accueils relais pour les urgences et des micro-crèches implantées dans les bourgs-services.
Augmenter le nombre de jours de congés pour enfant malade. Ces jours de congés supplémentaires seraient accordés à l’ensemble des salariés sans distinction de genre ou de territoire, afin d’éviter toute discrimination à l’embauche ou de créer des écarts de droits entre salariés issus de différents territoires. In fine, ce sont les femmes qui bénéficieraient le plus de ces congés supplémentaires pour les enfants malades, puisque ce sont elles qui gèrent, en grande majorité les interlocutions entre leurs enfants et le monde médical. Au sein des déserts médicaux, ces jours supplémentaires permettraient aux femmes d’accompagner leurs enfants chez le médecin sans entamer leurs jours de repos ou leur niveau de rémunération. Les femmes rurales célibataires avec enfant étant les plus isolées pour faire face aux conséquences d’un enfant malade, elles seraient le public le plus positivement impacté par cette mesure.